Climats, paysages, inscape (au bord du Volcan, 2)
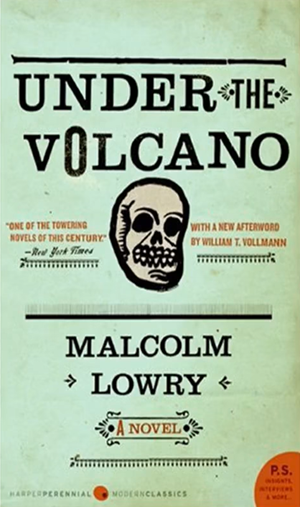
La partie qui précède [voir ici] est quelque peu confuse. Je ne cherche pas à m’en excuser. Celle-ci le sera tout autant. Davantage peut-être. Question de méthode : mon approche consiste à prendre le texte bêtement. Non pas ligne à ligne, je n’en aurais ni la force ni l’envie, mais comme il me prend. Je ne saurais dire si le pronom est référentiel ou non ici : le roman de Lowry me mâche, me travaille, me boulotte. Au point que son « il » relève pour moi du temps qu’il fait.
À mieux dire, le Volcan est une somme de climats à lui tout seul. On pense à Laruelle au chapitre premier, personnage aussi égaré dans ce roman que le lecteur ou la lectrice, Laruelle qui pourtant connaît bien les lieux : « De quelle perpétuelle, de quelle saisissante façon changeait le paysage ! […] Une planète sur laquelle, en un clin d’œil, l’on pouvait changer de climat et, s’il vous plaisait d’y penser, au croisement d’une grand-route, trois fois de civilisation… ». Du climat au paysage, la distinction est infime chez Lowry. Allez savoir, qui du climat ou du paysage est en charge de l’autre, qui des deux a force de civilisation.
Hantés par l’amour pour Charlotte, les restes abjects du palais de Maximilien évoquent le Consul, ou son fantôme, son amour pour Yvonne : « La chapelle disloquée puante, fouillis de mauvaises herbes, les murs croulants éclaboussés d’urine sur lesquels des scorpions se tenaient tapis — entablement rompu, triste archivolte, pierres glissantes couvertes d’excréments — ce lieu, où l’amour jadis s’était navré faisait figure de cauchemar. » Le destin du Consul et de Maximilien Premier, Empereur du Mexique, partagent un aspect grotesque et pathétique dont Werner Herzog aurait pu tirer parti (imaginons le Consul joué par Klaus Kinski et non par Albert Finney).
Le paysage de Lowry est jonché de ruines, et le Consul en est l’habitant sublime et tragique. Telle cette carcasse d’auto, tristement abandonnée : « [Laruelle] passa près d’un champ où une Ford d’un bleu passé, épave totale [total wreck], avait été poussée sur une pente derrière une haie : on avait glissé deux briques sous ses roues de devant pour éviter tout départ involontaire. » Image évidente du Consul mis au placard (derrière la haie de sa propre culpabilité), figure dérisoire du fatum, cette vieille Ford est jetée là, irrémédiablement calée par des briques. C’est l’enfer, on ne bouge pas. Tout ce qui tourne autour de moi — total wreck, épave sublime dans une ébriété colossale et constante —, c’est le paysage, mes climats intimes et cosmiques.
Le Volcan en appelle à une lecture atmosphérique, de sorte à en bien contracter les miasmes. Ainsi, piétinant au bord du Volcan, nous n’avons guère avancé, laissant à l’horreur le loisir d’incuber lentement. Des choses ont été dites déjà, oh ! confusément, au sujet du chapitre premier de ce roman parmi les plus terribles qui soient. Terrible, à comprendre ici comme on dit des sonnets de Gerard Manley Hopkins qu’ils furent des « sonnets terribles » (ou de terreur, comme le propose Pierre Vinclair). Lowry fait d’ailleurs allusion au poète de « Carrion Comfort » dans sa préface au Volcan, mais il me semble que c’est l’ensemble du roman qui relève d’une expérience intérieure comparable à celle de Hopkins. Quelque rapport lointain, comme astral, peut donc se deviner. Ce d’autant que les auteurs sont nés chacun un 28 juillet.
Pour diamétralement différents que soient les tempéraments de Lowry et de Hopkins (l’alcoolique impénitent et le jésuite mortifié), c’est un semblable inscape, ou paysage intérieur qui est à l’œuvre chez eux. Je me borne à comprendre l’inscape de Hopkins comme un « paysage intérieur », définition sage et il est vrai peu risquée. La manière dont le paysage est subjectivé dans le Volcan, ou dont la conscience s’imbrique dans le paysage (c’est tout un) me semble appartenir à un phénomène de cet ordre.
Le Mexique défilant sous ses yeux dans toute son impénétrable étrangeté, Laruelle se souvient du Consul, en ce Jour des morts de l’année 1939. Ce souvenir nous est inscrutable. Il nous arrive par saccades incompréhensibles, ourdies, qui sait ? par Geoffrey Firmin, « comme si le Consul avait tout calculé ».
La suite suivra.



