[première partie de l’entretien]
Mathieu Jung — Lors de notre rencontre à Paris, tu m’as fait découvrir l’œuvre de François Jacqmin, dont tu m’as vivement conseillé Le Domino gris (2017). Il est une sensible similarité entre le travail de Jacqmin et le tien. Le goût pour la forme ramassée, par exemple, semble vous rapprocher. Peux-tu en dire davantage ?
Serge Núñez Tolin — Heureux, bien cher Mathieu si Le domino gris et, j’espère au-delà, l’œuvre de François Jacqmin (1929-1992) te rallie à ces pages déterminantes pour la poésie que je tente mais, je le crois, avant tout pour l’ensemble de la poésie de nos générations. Je dirais qu’en moi, la poésie de François Jacqmin a pris le relais après l’apport primordial des livres de Roberto Juarroz (dans les traductions de Fernand Verhesen ou Roger Munier).
De quoi parle-t-on ? Dans l’esprit d’exploration, dans la découverte d’une manière d’exister et la nécessité de mettre celle-ci par écrit sous la forme du poème, je serais passé d’une verticalité à un horizon du monde où poser mon propre pas. De la poésie verticale de Roberto Juarroz (selon la notion de la chute et de la station debout comme la montré Roger Munier (cf. Poésie 90, n°35, p.13) à celle des éléments de Jacqmin.
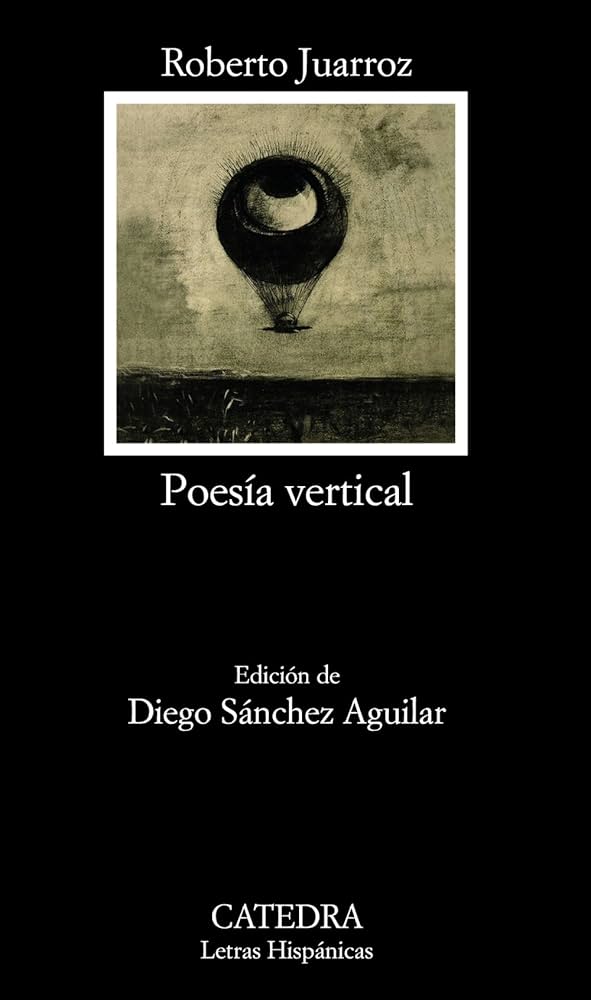
Tout a commencé par les intuitions ou les positions que je partage avec mon grand aîné. D’abord, il faut compter avec la défiance à l’égard des mots. L’écriture se développe constamment en passant par un état réflexif, le poème pense aux moyens que sont les mots, ce véhicule par lequel il doit en passer. Rapidement, des limites circonscrivent le domaine : « Ma recherche est la recherche de tout un chacun, c’est de vivre en paix. Je ne pense pas que l’exercice de la poésie soit le bon moyen, figurez-vous. » (in Pascal Goffaux, Parole gelée François Jacqmin, 2006, p. 8). C’est en ce sens, notamment, que la question de la forme importe peu. À vrai dire, je n’y ai accordé que très peu de place. Il semble que ce fut aussi le cas pour François Jacqmin. La question de la forme, sans avoir été posée, s’est réduite à l’arrivée telle quelle de la prose dans le poème.

À ce propos, je trouve remarquable les auteurs (Christian Hubin, Patrick Wateau, etc.) qui écrivent, autant qu’il se peut, hors de la syntaxe ou dans son éclatement et, par là-même, montrent à l’égard des mots une confiance telle qu’ils les voient capables d’autonomie et lui délèguent, en l’état, la capacité de parler au lecteur. Ceci dit, sans que la syntaxe soit dans mon esprit un dieu intouchable. Pas de dieu(x) dans le monde ni dans la langue.
Comme Jacqmin, donc, j’ai trop de réserves à l’égard des mots pour croire en leur autonomie. Par parenthèse, ce n’est pas la situation de la peinture abstraite. La méfiance à l’égard des mots recouvre également celle à l’endroit de la pensée. « La pensée me gêne dans la mesure où elle m’éloigne des éléments » (id., p.12). C’est bien de la pensée occidentale, rationaliste à outrance et anthropocentrée (sans parler de son occidentalo-centrisme) dont on traite.
C’est évidemment la question de l’être qui m’aura retenu pour la vie et avec l’écriture. C’est dans mon parcours, Roberto Juarroz « Ce n’est plus être ou ne pas être mais être et ne pas être. » (que je cite ici de mémoire) qui m’amène à considérer l’incertitude et à envisager le doute dans toute son ampleur comme moteurs de l’élan vital. J’ai trouvé chez Jacqmin à prolonger cette exploration de l’être : « Je ne pouvais vivre en poésie sans le sentiment très vif de l’échec prolifique que constituait l’idée de l’être. […] C’est dans mon incapacité de résoudre son implacable mystère que je puisais le plus grave et le plus léger de moi-même. […] Je me réjouis de ce perpétuel / impossible / […] / C’est en vain que la nuit me pousse vers les lettres. […] Mes contradictions m’épuisent et me font exister. » (François Jacqmin, Le poème exacerbé, 1992, pp. 57-58).
C’est à partir du sentiment produit par l’œuvre même de François Jacqmin, le sentiment de l’insuffisance des mots comme de la quête ontologique qu’est advenu le second temps. En effet, à partir de la conscience exacerbée de la vanité d’œuvrer dans ces insuffisances m’est venu la nécessité de faire place au corps, à la marche qui, traversant les mots, les dépasse :
« Les mots, je m’y trouverais cantonné si la marche ne les traversait. Le corps s’y est mis et ramène la réalité dans la maison où portes et fenêtres restent constamment ouvertes. » (Le monde est sans remède, en cours d’écriture).
Je me suis alors détaché de la lecture de ses livres poursuivant ailleurs mais profondément et décisivement transformé par sa poésie. Tout se passe dans les livres de François Jacqmin comme s’ils allaient vers une sortie paradoxale, une sortie sans issue dont le poète a eu l’intuition qu’il pouvait y accéder en pénétrant le galet des choses. Entrer dans les sensations, entrer dans les choses, pénétrer le monde où nous sommes, dont, en fait, nous sommes. « Lorsque nous prétendons nous abîmer dans la recherche du sens ou du processus de la création, nous sommes d’abord accueillis par une odeur. » (Le poème exacerbé, 1992, 135).
Pour finir, ce qui n’a d’ailleurs pas de fin, j’ai trouvé à partager dans les livres de Jacqmin une même fascination pour la tautologie : « La tautologie, c’est-à-dire l’affirmation répétitive, la confirmation insécable, le retour du même au même, l’infatigable évidence, à la fois l’espoir et le désespoir de l’intelligence, la tautologie, dis-je, est un des ressorts les plus puissants de ma poésie. […] J’ai le sentiment que la tautologie élève le texte à la hauteur de ce qui est : elle n’invente rien et ne dissout rien. La tautologie revient à sa première donnée, qui est effectivement une donnée, et non une création. » (id., p.79).
Les mots mêmes ne seraient-ils pas une tautologie par excellence ? Ils seraient ainsi la métaphore de ce que nous sommes en ce monde au plan de l’être. Nous nous servons des mots pour nous exprimer, en l’occurrence, ici, exprimer notre rapport aux choses, notre contact avec le monde. Mais, en faisant usage des mots, nous ne parvenons pas à toucher au monde, ni à le pénétrer, ou, moins encore, à nous en rendre maître comme l’esprit encyclopédiste du XVIII/XIXèmes siècles l’avait ambitionné dans une perspective d’abord rationaliste et ensuite positiviste. Toujours est-il que nous restons enfermés dans ce corpus de mots que nous ne pouvons empêcher malgré tout. Je le vois comme un échafaudage, une sphère armillaire absurdes. Finalement, nous serions comme ce petit rongeur activé sans fin dans sa roue emporté par le mouvement des mots qui constituent ce moulin.
L’œuvre de François Jacqmin est pour moi l’une des grandes sources quant à notre façon d’être humain ici et maintenant. Rien de moins. J’engage chacun et chacune à y aller voir.
(3 juillet 2024)

M. J. — Que tu parles de tautologie n’est pas sans faire écho au travail de Laurent Albarracin. Il note, tout au début de son De l’Image, que « la tautologie est […] le sommet caché, impossible de la poésie ». En un sens, la tautologie, qui serait a priori le degré zéro, ou bien ultime, de l’analogie, est en réalité la métaphore continuée selon des moyens différents, pour paraphraser une formule célèbre de Clausewitz. Ce dernier parlait de la guerre, mais il y a sans doute dans l’analogie — dans l’image — une tension qui relève du conflit entre des termes qu’elle vise à rapprocher. Il me semble que ta poésie ne soit pas explicitement une poésie de l’image, bien qu’elle vise à donner le monde à voir, tel qu’il est, selon sa criarde tautologie au besoin. Tu écris, dans Sur le fil de la présence (Le Taillis Pré, 2024) : « Être attentif aux choses, sans rien savoir d’elles, si ce n’est qu’elles sont ce qu’il y a, c’est se retrouver devant les mots. » Les choses sont ce qu’il y a… L’étau tautologique est ici resserré, mais les mots se présentent néanmoins, vecteurs d’expression, qui débordent le silence. Tu écris, à la page suivante : « Matière à silence dans l’ordre de ce qui est. Soudain, les deux ne coïncident plus : je m’y suis interposé. » Dans quelle mesure l’interposition du « je » de ton énonciation travaille-t-elle sur la non-coïncidence des choses à elles-mêmes ? Ou alors, devrais-je demander, dans quelle mesure ta subjectivité vise-t-elle, compte tenu des mots, à prendre le parti du monde ?
S. N. T. — Tout d’abord, je ferai la distinction entre métaphore et image. Pour cela, je mettrai en œuvre l’éclairage que Jacques Vandenschrick (tous ses livres chez Cheyne éditeur) a porté sur ces notions lors de la présentation en librairie de Les mots sont une foudre lente, Rougerie, 2023 (À Livre ouvert, Bruxelles, le 25.06.2023).
Dans la poésie que je tente, il pointe l’attention constante mise à éviter tout lyrisme et à préférer une forme d’objectivité presque nominaliste dans l’évocation des objets appelés à figurer dans les poèmes.
Les mot sont ainsi placés loin des illusions d’un sens second qu’ils cacheraient par devers eux et qui viendrait vibrer sous leur évocation. La table évoquée est une table, la fenêtre une fenêtre, le réel est là comme il est. Les choses défilent dans le texte par description stricte d’images. L’image est sans verso. On ne la retourne pas pour voir ce qu’il y aurait en dessous. (J.Vdsk)
L’écriture s’écarte ici, par sobriété, de toute prétention métaphorique qui ferait s’iriser autour d’elle un champ de significations. Aussi, la situation semble être « image versus métaphore » en une sorte d’indifférence du discours. Ou d’attente ? (J.Vdsk)
Mathieu, pour commencer à te répondre donc : tu traites de la tautologie comme de la métaphore continuée selon des moyens différents, en transposant la pensée de Clausewitz de la guerre à la métaphore. Tu poursuis en précisant qu’ « il y a sans doute dans l’analogie — dans l’image — une tension qui relève du conflit entre des termes qu’elle vise à rapprocher ». Je te suis, s’il ne s’agit pas tant de rapprocher des termes opposés mais d’en admettre la contradiction ou l’opposition. Par exemple, pour aller à l’essentiel, admettre la mort dans la vie, sans plus opposer l’un à l’autre (voir plus haut, Roberto Juarroz), sans voiler la première pour permettre la seconde (La philosophie tragique, Clément Rosset, une fois encore). Je tiens pour fondateur, précisément dans le domaine de l’écriture — pour un moteur parfaitement opérant — le principe de tension, de la simultanéité des contraires comme reflet de ce qu’est le vivant. De manière plus générale et, en regard de l’histoire littéraire, je me sépare ici du principe surréaliste qui considère la métaphore comme la « rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. » (Lautréamont).
En allant plus loin dans ta question, je rappelle que, très tôt, nous apprenons combien le réel ne découle pas de nous. Que l’on mobilise la voie rationnelle ou la voie de l’imaginaire. La réalité nous est extérieure et si, dès la prime enfance, tout se passe de manière à tendre à l’équilibre, nous l’acceptons en acceptant la place que ce monde, là avant nous, voudra bien nous faire. Ceci peut aussi bien être l’apprentissage de toute une vie.
L’écriture qui m’accompagne sur le chemin est un exercice de silence. Un exercice qui consiste notamment à se délester de soi. En ce sens, les mots interfèrent avec le monde s’ils visent à l’entreprendre pour le tirer vers soi comme un centre. Nous ne sommes le centre de rien. Il n’y a d’ailleurs pas de centre. Nous sommes une partie du monde donné et ce n’est pas le recul de la conscience qui ferait de nous le centre du monde ni son sommet. Il n’y a, pour moi, que l’immanence, les présences. L’accepter m’allège.
Aussi la métaphore, dont je crois ne plus me servir depuis fort longtemps (sans doute cela a-t-il été le travail des premiers livres (Silo, etc.) sans pourtant que je n’en mesure alors la portée, la métaphore disais-je, me paraît encore une manière de s’emparer du monde. Si les mots de la raison encyclopédique et positiviste avaient ouvertement ce but, le faire par le biais de la métaphore, comme au début du XXème siècle, les Surréalistes l’avaient projeté, en poussant cette volonté du côté de l’inconscient m’a semblé aussi peu acceptable pour notre aujourd’hui. Toujours est-il que la métaphore dans le Surréalisme fut poussée au maximum de ses possibilités, me la rendant désormais inutilisable. Comme, d’ailleurs, ont fait les « grands effondrements » du siècle passé.
Certains poètes, bien avant, avaient défait la poésie de tout ce qui la constituait. J’entends ici l’art de la versification, les rimes et les pieds, toutes leurs nomenclatures variées et codifiées qu’un Louis Aragon maîtrisait encore à la perfection par-delà Lautréamont, Rimbaud, Cendrars, etc. Pour imager le propos, ne peut-on dire que tout s’est passé en poésie comme en architecture aux tournant des mêmes XIX/XXèmes siècles ? Adolphe Loos, Walter Gropius, Henri Van de Velde, Le Corbusier et quelques autres pour lesquels « l’ornement est un crime » en sont venu à ne conserver que la forme au plus près de sa fonction.
Est-ce ce que j’ai pu faire, sachant que l’on peut (on devrait) dénier toute fonction en poésie ? Quoiqu’il en soit, je ne garde du poème que les mots, aussi respectueux du silence qu’ils peuvent l’être. Aussi peu d’effets que possible. Un simple compte rendu de nos présences, de l’apprentissage que cela implique de vivre, d’être une présence. C’est en ce sens qu’il me paraît bien abusif de s’interposer entre les choses : notre conscience ne nous donne pas ce droit. Placer sa ratio entre les mots et les choses revient à anthropomorphiser le monde. Appropriation déplorable, aussi violente dans les faits qu’abusive en esprit. Je, le présent que l’on est (titre d’un inédit daté de 2006-2007) : rien de plus.
Par large extension, c’est aussi en ce sens que je me sens très rétif face à la raison occidentale qui, pour faire court, est la nôtre depuis la fin du XVème siècle et l’avènement graduel d’une pensée anthropocentrée que, plus tard, René Descartes posera en repère historique par son célèbre énoncé « Cogito ergo sum — Je pense, donc je suis ».
C’est en ce sens que va mon intérêt pour les travaux de Claude Lévi-Strauss et les démarches anthropologiques contemporaines relatives à la « pensée des peuples premiers ». En ce sens aussi que la préoccupation écologique me convainc parfaitement (si jamais l’état de la planète et de son climat n’avaient pu le faire) autant pour le cours du monde qu’au plan philosophique.
Nous sommes un fragment dans un continuum qui englobe le vif et l’inerte en une interrelation dynamique. Et la poésie y est une toute petite chose. Mais elle y est.
(06 juillet 2024)

M. J. — Cette poésie comme pratique de l’infime n’est pas sans évoquer Rilke pour moi, qui parle d’un amour des petites choses, « diese Liebe zu den Geringen… », dans ses Lettres à un jeune poète. Si je devais te rapprocher de Rilke, ce serait peut-être à l’endroit de ses Quatrains valaisins, dont en voici un :
Peuplier, à sa place juste,
Qui oppose sa verticale
À la lente verdure robuste
Qui s’étire et qui s’étale
Pour autant, je ne dirais pas de ton approche qu’elle est strictement lyrique…
S. N. T. — Non, en effet, je ne le dirai pas plus que toi ! Avant de te répondre, dire, et je ne saurais plus pour quelle raisons à l’époque, sans doute la hauteur de l’œuvre et sa force suffisent, que j’ai aimé les livres de Rainer Maria Rilke. Je l’ai lu dans une édition des œuvres complètes. Je garde entre autres une impression très forte de Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Il fait partie de mon commencement. J’espère pouvoir bientôt revenir à ses pages.
Tu parles de l’infime. Oui, ce que nous sommes et la vie que nous traversons avant de ne plus y être. Observons d’emblée que l’infini n’écrase ou n’empêche en rien l’infime. Dans cet infini, nous sommes une possibilité. À ce titre, loin du sublime, corollaire ordinaire du lyrisme, nous pouvons davantage nous diriger vers l’infime que nous laisser aimanter par l’infini. Voici dans ce contexte comme dans d’autres, un poème d’Henry Bauchau, extrait de « Nous ne sommes pas séparés » (2006, 70) :

Ce texte peut être lu pour ses riches et profondes résonances dans le domaine de l’existence personnelle. On perçoit les implications de ces deux notions opposées, toutes deux formulées par la négative comme si chacune réclamait une lutte du « Moi » pour retrouver l’équilibre de la marche. Ce sens de la lecture, je n’ai pas manqué de l’appliquer. Ce distique me sert encore tous les jours. C’est le Combat avec l’ange (Eugène Delacroix) du moins, dans l’une de ses prises…
Mais ce poème m’est venu ici en lisant ta question ! Car, en effet, de quoi s’agit-il quand on parle de lyrisme ?
Le lyrisme, c’est le point de départ du poème. Si le poète est lui-même ce point de départ, ce dernier apparaît, par définition, comme un centre. De cette éminence provient un texte orienté par le point de vue unique de son auteur. Le monde est écrit dans une dépendance complète de la subjectivité de l’écrivain. L’effusion lyrique qui s’ensuit conduit aux projections de soi les plus débridées sur le monde extérieur. Le véhicule même de ces effusions, les mots, ne peuvent manquer de s’en imprégner. Plus rien n’échappe à l’auteur. Il est à lui seul le centre et la totalité. C’est une fiction impossible à tenir aujourd’hui.
Bien entendu, j’ai poussé le curseur au plus loin. Mais il n’en reste pas moins que la création résulte de la tension créatrice constante entre les deux pôles si parfaitement situés par le poète (romancier et psychanalyste) H. Bauchau.
Plus haut, j’ai brièvement évoqué les « effondrements » du XXème siècle. Revenons-y, en tenant le rôle du « bonhomme-système » selon les portraits ironiques dressés par Jules Verne dans ses romans d’aventure.
Au tournant du siècle, « Dieu est mort ». Sa fin nous est signifiée par Friedrich Nietzche dans Le gai savoir en 1882. Sigmund Freud fonde une certaine fin du sujet et de la ratio par la mise au jour de l’inconscient. L’homme n’est plus essentiellement un sujet qui pense le monde, il est mû et pensé par une instance interne qui lui échappe. Ensuite, la guerre 14-18 est l’avènement de la guerre industrielle et des moyens de la science mise à son service, sans parler des motivations sourdes du conflit dans le capitalisme financier, industriel et colonial. 1917 est le début de l’effroyable désastre de l’espérance humaine ruinée dans le communisme réel. L’hégémonie fasciste s’instaure en Europe entre 1922 et 1945 de l’Italie à la France, en passant par l’Espagne et le Portugal, … Et, toujours évoqué dans une incommensurable douleur, le génocide des juifs d’Europe ainsi que les deux bombes atomiques lâchées par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki. On ne peut prétendre que les temps ultérieurs soient cléments mais la première moitié du siècle passé a atteint, jusque-là, des sommets dans la déréliction.
Pour quelqu’un de ma génération (je suis né en 1961), il a fallu dépasser les constats établis après la guerre par Adorno, Paul Celan et Beckett : sinon l’impossibilité, l’empêchement intérieur de créer. Le lyrisme comme effusion avec le monde devint instantanément caduque. Aussi, me poser comme sujet dans l’écriture me paraissait inadmissible, d’une prétention sans limites. Les deux instances nécessaires à une poésie lyrique, « le monde » et le « je » avaient complètement versé et restaient inutilisables pour le poète responsable.
Deux décennies après la guerre, d’autres courants de pensée allaient ajouter au monde effondré leurs propres raisons quant à la disqualification du « je ». En effet, la réception d’un structuralisme exclusif ainsi que l’hégémonie de la psychanalyse sur le commentaire et la pratique dans les arts plastiques et littéraires commencèrent à dominer la création et les esprits (et surtout en France). Quant au champ littéraire et, particulièrement, à sa pointe, dans le domaine de la poésie, le groupe « Tel quel », entre autres, avait participé à établir la création poétique dans une aporie terrassante. Ses théoriciens et poètes postulaient l’autonomie complète du texte. En l’occurrence, le poème sans l’écrivain, la poésie sans auteur ou autrice. Un nouvel académisme avait cours. De toute façon, la question du lyrisme était réglée, l’histoire était passée là.
Des années m’ont été nécessaires pour percer l’impasse, retrouver, malgré la doxa, l’expression d’un rapport au monde, l’élan vital et me permettre d’affirmer ma propre personne comme l’émetteur : retrouver malgré tout le « je » si rudement et à raison mis en cause !
Il doit en rester quelque chose, aujourd’hui, au vu du rôle toujours important tenu dans mes pages par l’infinitif, le mode impersonnel et l’usage du pronom personnel indéfini, etc. !
Dans le voyage de l’œuvre ce sont « Les quatre livres de la marche » et leur « Épilogue » rédigés entre 2007 et 2011 (tous inédits) qui en retracent l’aventure, la bascule vers l’expression directe du rapport au monde en passant par un « je » décidé bien que sans certitudes.
Pour terminer, j’en viens à la notion de lyrisme critique qui dans les décennies 1980-1990 a accompagné la diffusion de l’œuvre de Roberto Juarroz (1925-1985) dans le domaine francophone. Ce mouvement d’intérêt pour l’œuvre du poète argentin a contribué à l’émergence d’une forme renouvelée et lucide du lyrisme, dans l’esprit des critiques comme dans celui des poètes. On aura vu que les notions de monde, de sujet et de présence ressurgissent à la faveur de poètes tels que P. Jaccottet, les livres posthumes de Joë Bousquet (tous parus chez Rougerie éditeur), Roger Munier, B. Noël, etc.
J’ajouterai ici pour leur rôle, en ce qui me concerne, la découverte en ces années des livres de Fernando Pessoa, Antonio Ramos Rosa, Antonio Porchia et les titres à la suite de Ostinato de Louis-René Des Forêts, …
Cher Mathieu, mes réponses à tes questions, pour lesquelles, je le reconnais, je n’ai pu assez m’écarter du jeu narcissique, me conduisent maintenant à une observation de fond quant à ce que j’ai déjà nommé plus haut, le « voyage de l’œuvre ».
Il m’apparaît aujourd’hui dans ce que j’ai pu écrire qu’il y a une constante et une cohérence de renvoi entre le silence, le secret des destinées particulières ici-bas et l’immensité du silence qui nous environne. Notre silence infime renverrait son écho à l’immensité de silence, l’infini de silence.
De même, il en serait de l’usage du monde comme de l’usage des mots. Dans le choix des mots, nul arrière-fond, pas plus de métaphore derrière les mots que de dieu(x) derrière l’homme ou le monde. Dans mon écriture, l’image est terre-à-terre, rien d’autre à voir que la présence de la chose imagée.
Je perçois donc une analogie de renvoi entre le monde réel qui m’apparaît sans transcendance : qui n’est que ce qui est et que ce qu’il y a, d’une part et, d’autre part, la présence infime des choses et des actes qu’elles réclament, où nous nous trouvons vivre et qui ne sont jamais rien d’autres que ce qu’il y a et ce qu’il y a à faire.
De même que dans l’emploi des mots pour le dire, en toutes ces choses : de l’infini à l’infime : il y a l’immanence, rien d’autre que l’infime qui est notre sol. Le précieux infime.
Tout ceci, peut-être est-il lyrique ?
(09 juillet 2024)



