Avec Los Angeles et le radici della cultura pop (Odoya, 2024, 350 pages) [Los Angeles et les racines de la culture pop, à ce jour inédit en français], Claudio Castellacci dresse l’inventaire de ce que Los Angeles représente pour lui et nous offre un agréable panorama pop relatif à cette ville. Cela commence avec une vue depuis les Pacific Palisades, et l’on enchaîne très vite sur quelques aperçus et souvenirs liés à la Cité des anges et ses alentours, entre le Grand Canyon et Zabriskie Point, dont l’auteur a le front de dire que le film d’Antonioni inspiré par ce lieu est d’un « ennui absolu ».
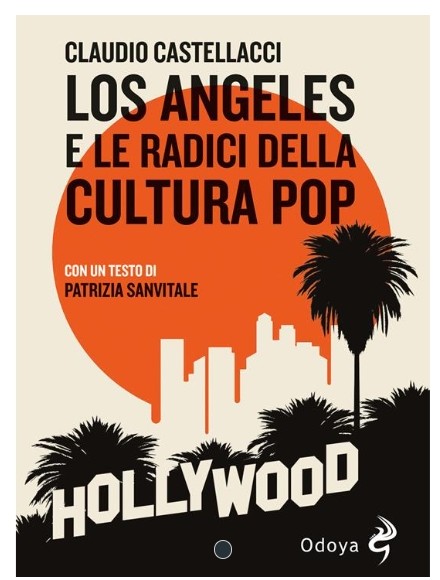
Au fond, le soft power, comme Castellacci ne manque pas de le rappeler, est une incitation culturelle plus forte et irrésistible que toute forme de coercition. Bien sûr que Zabriskie Point est génial, ne serait-ce que pour sa bande originale, mais notre appréciation de ce film un brin ennuyeux il est vrai (la chiantine comme garantie du caractère sérieux de l’objet culturel, de son incontestable valeur qu’un snobisme certain ratifie par avance) — notre goût indéfectible pour l’époque et le lieu qu’Antonioni parvient à fixer dans l’imaginaire collectif ne sont-ils pas tributaires d’un habile et obstiné travail de façonnage de notre culture ? Zabriskie Point aurait dû finir, selon le souhait du réalisateur italien, sur un gigantesque « FUCK YOU AMERICA », tentative en somme de désamorcer ladite entreprise d’influence dont participe, bon an mal an, ce film très beau mais quelque peu pédant.
Los Angeles et les racines de la culture pop revient sur une ère culturelle qui a longuement infusé dans notre Occident à bout de course. L’ouvrage, très riche, fourmille d’anecdotes et propose autant de coups de sonde au cœur de cette L.A. peut-être davantage rêvée que véritablement vécue. Non que l’expérience qu’en firent Castellacci et Patrizia Sanvitale (qui étudie ici le phénomène New Age) pèche en matière d’authenticité, mais le caractère spectaculaire-marchand de L.A. gouverne, pour une très large part, ce que l’on a coutume de nommer le rêve américain. Surtout, l’écriture journalistique autorise ici idéalement la divulgation de quelque chose qui pourrait s’apparenter au document vécu de ce rêve précisément, où l’on croise Andy Warhol, Captain America, Marilyn Monroe, les Beach Boys, Walt Disney ou encore Philip K. Dick.
Ce livre prolonge agréablement les essais que Mike Davis et Bruce Bégout consacrent à L.A. Je regrette, mais on me voit venir, qu’on n’y parle guère de L.A. Woman des Doors (une seule allusion, à la page 215) — l’excellent Waiting for the Sun de Barney Hoskyns, admirable synthèse sur la musique californienne des années 40 à 2000 comble assez bien ce manque.
On sait néanmoins gré à Castellacci de consacrer quelques pages aux Byrds, groupe dont on ne mesure peut-être pas encore, du moins en Europe, toute l’influence. Pour autant, la traversée de L.A. ne sappesantit pas, ou tout juste ce qu’il faut, sur la parenthèse flower power et l’abomination de Cielo Drive. Un chapitre étudie la naissance de la groupie en Californie, à travers notamment les personnalités de Pamela Des Barnes ou de Chris O’Dell, sans oublier bien entendu Cynthia Albritton (aka Cynthia Plaster Caster), rendue célèbre par ses moulages génitaux de Jimi Hendrix, Frank Zappa et quelques autres.
On lira également de belles pages au sujet d’Eve Babitz, qu’une photographie célèbre montre jouant aux échecs avec Marcel Duchamp. Bref, c’est tout L.A. qui est ici superbement mise à nue, et l’on est amené à mieux saisir le fonctionnement de cette « fabrique du rêve occidental », selon l’expression d’A.M. Homes.

Castellacci signe un livre très personnel, agrémenté de nombreux documents, dont ces photos où l’on voit le journaliste en présence de Douglas Kirkland ou de Peter Falk. Peut-être que le chapitre le plus intéressant de cet ouvrage foisonnant est celui qui porte sur le genre du polar, nous éclairant au sujet d’un territoire qui s’étend de Raymond Chandler à l’inspecteur Columbo, sans oublier l’affaire du Dahlia noir telle que James Ellroy à su la fixer dans notre imaginaire.
Car c’est bien de cela dont il est question, d’une réalité qui relève de l’imaginaire sinon du fantasme, lorsqu’il s’agit de L.A., ville qui « n’existe pas » selon Ray Bradbury, ville tour à tour capitale du vingtième siècle (Bruce Bégout) et grandiose machine onirique qui n’a pas fini de produire du mythe.



