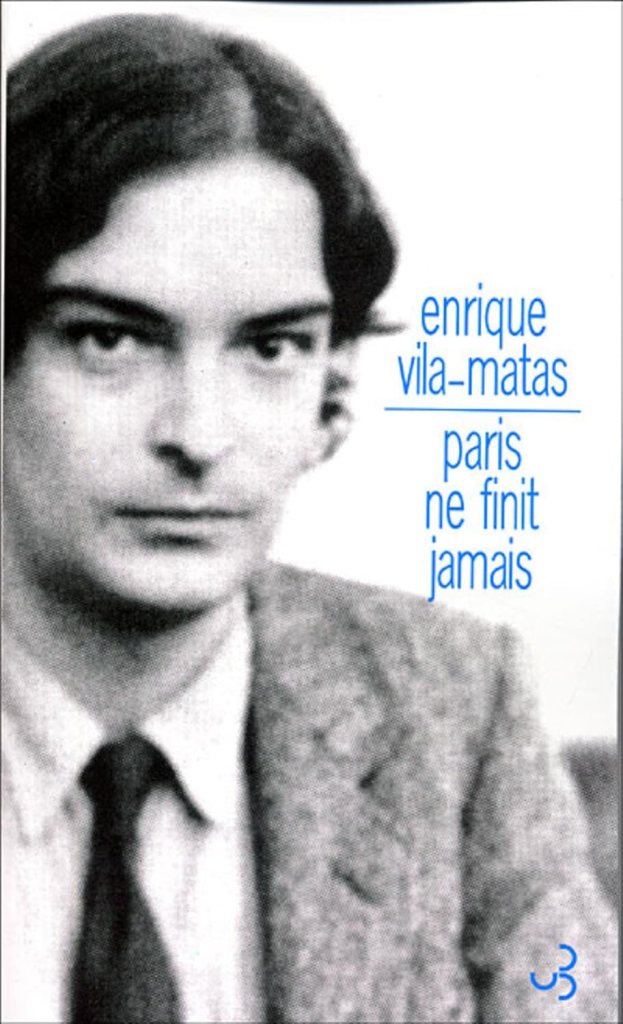
Me revient cette lubie d’un portrait de lecteur. Ou du portrait de la lecture. Il m’arrive, dans mes moments les plus ridiculement exaltés, de rêver à une phénoménologie de la lecture. On en est là. Inéluctable modalité du lisible, etc. Faut-il, ne faut-il pas tenir compte de l’état d’âme de la lectrice ou du lecteur quand on s’engage dans la rédaction d’une biographie ou, à plus forte raison, d’une autobiogaphie de ce lecteur ou de cette lectrice? Et de son état de santé? Une escapade à Paris et tu attrapes une crève de tous les diables — tu te sentais tomber malade aux puces de Saint-Ouen, déjà, au courant de la matinée. Tu as mendié, même, un Doliprane à Maria.
Ce refroidissement, ce rhume, cette toux, cette céphalée fébrile entrent tels quels dans le roman que tu es en train de lire, et presque en prennent possession. Il s’agit de Paris ne finit jamais, d’Enrique Vila-Matas. Lecture doucereuse, somnolente, enchâssée dans Dublinesca, dont tu as interrompu la lecture nel mezzo del cammin, pas sûr que tu le reprennes. Tu as le même sentiment de lassitude à la lecture de ce Paris ne finit jamais. Ce d’autant que Paris, depuis quelques années maintenant, te fait chier. Cette ville a perdu le caractère merveilleux qu’elle avait pour toi avant. Avant quoi? Il faudrait développer ce point, mais est-ce que cela entre dans une quelconque autobiographie de lecteur? Peut-être : Paris est pour toi liée aux livres, incontestablement. Par exemple, lorsque tu approches de Paris, en train, et que tu arrives au niveau d’Ussy, tu ne peux t’empêcher de penser à Beckett, qui avait sa maison là.
Les livres de Vila-Matas semblent pourtant faits pour toi. Paris ne finit jamais n’est autre qu’une autobiographie de lecteur, une sorte de roman d’apprentissage aussi bien. Mieux : tu t’y retrouves, toi, dans ce portrait de lecteur jeune homme en écrivain en devenir, dans ce portrait d’écrivain en lecteur jeune homme, avec toutes ses hésitations et tergiversations.
Autant lire Proust, finalement. Tu penses à Proust parce que tu laisses filer distraitement un documentaire qui lui est consacré, pendant que, passablement enrhumé, tu lis les aventures de Vila-Matas du temps où il logeait chez Marguerite Duras. Proust aussi propose une sorte de Bildungsroman dans l’écriture. Et son extraordinaire essai sur la lecture t’invite à dire que oui, il convient bel et bien de faire figurer les états d’âme dans l’expérience autobiographique dont tu parles.
Tu prends la décision de relire Sur la lecture, quand tu n’auras plus la fièvre. Sans doute que la relecture de Sur la lecture t’apportera quelque chose en matière de lecture. Ce serait à désespérer de tout autrement.
Le documentaire sur Proust continue de défiler, on y entend la voix de Céleste, on y parle de l’église de la Madeleine, et cela te fait sourire que Marcel, capitonné dans sa chambre, pouvait entendre les cloches de la Madeleine. Tu lis Paris ne finit jamais dans le violent désir de lire Proust. Le livre que tu aimerais lire maintenant (les Écrits sur l’art de Proust, en GF Flammarion) se trouve dans l’autre pièce, de l’autre côté du mur, il est trop loin, et, surtout, tu es enfin parvenu à une posture presque douillette dans la fièvre, sous la couette, tu n’as pas trop mal à la tête, ni au dos, ni n’éprouves le besoin de trop tousser, les glaires sont en bon ordre, dingue ce que tu as pu cracher tout à l’heure dans l’évier — tu ne courrais pas le risque d’un nouvel inconfort, mais le violent désir de Proust te rend Vila-Matas un peu terne, alors qu’il se démène franchement pour amuser la galerie.
Les choses auxquelles on pense, lorsqu’on lit.
Quelquefois, lorsqu’on tient une belle fièvre comme la tienne, l’œil se contente de parcourir la page, pas vraiment en diagonale, en zig-zag plutôt. Symbolic deciphering, pour parler comme Ian Watt, auquel tu penses souvent. Tu songes à Ian Watt, que tu lisais naguère d’assez près, tandis que tu parcours plus que tu ne le lis le passage où le narrateur de Paris ne finit jamais raconte un trip sous LSD. Non que cela t’ennuie, c’est même ouvertement prévu pour être divertissant, simplement, ta lecture est quelque peu flottante (il est au reste fort rare que les récits sur les drogues ne soient pas futiles, banals dans ce qu’ils sont censés avoir d’extraordinaire — souvent, tu repenses à Marshall McLuhan qui estimait que le LSD est le Finnegans Wake du pauvre), et tu repars en arrière, sur un des passages que Vila-Matas consacre à Duras (tu l’as marqué de coches au crayon, parce que tu estimes qu’il est important et très beau, ce d’autant que tu n’as jamais bien saisi l’engouement pour Duras) :
Je garderai à jamais le souvenir d’une femme violemment libre et audacieuse, qui incarnait en elle à tombeau ouvert — avec, par exemple, son usage intelligent du libertinage verbal, consistant chez elle à s’asseoir dans un fauteuil de son appartement et, avec une vraie cruauté, à dire tout ce qu’elle avait sur le cœur — toutes les monstrueuses contradictions qui se trouvent dans l’être humain, tous ces doutes, fragilité et désarroi, individualisme féroce et recherche de la douleur partagée, bref cette immense angoisse que nous sommes capables de déployer face à la réalité du monde, cette désolation dont sont faits les écrivains les moins exemplaires, les moins académiques et les moins édifiants, ceux qui ne cherchent pas à donner à tout prix une bonne image, une image correcte d’eux-mêmes, les seuls dont nous n’apprenons rien, mais également les seuls qui ont le courage de s’exposer littéralement dans leurs écrits — où ils disent tout ce qu’ils ont sur le cœur — et que j’admire profondément parce qu’ils sont les seuls à jouer le jeu à fond et me paraissent de vrais écrivains.
Ce sont des moments de la sorte qui rendent Vila-Matas réellement intéressant. Une fois admis qu’il envisage la littérature comme le sujet de son écriture, sans pour autant faire œuvre de critique, on avance assez gaiement dans ses romans. Mais peut-être que, quelquefois, les préoccupations de Vila-Matas touchent trop aux tiennes. La proximité que vous entretenez te gêne. D’autres fois, cependant, tu n’es pas mécontent d’être si proche de lui, de partager quelques rayonnages de bibliothèque avec lui :
Personne ne nous demande de vivre la vie en rose, mais personne ne nous demande non plus de vivre le désespoir en noir. Comme le dit le proverbe chinois, aucun homme ne peut empêcher l’oiseau noir de la tristesse de voler sur sa tête, mais ce que l’on peut évidemment éviter est de le laisser nicher dans ses cheveux. Au début de L’Anti-Œdipe, il nous est rappelé que Foucault disait que ce n’est pas parce qu’on est révolutionnaire qu’on doit se sentir triste.
Tu iras retrouver la citation dans le livre de Guattareuze, elle ne te revient pas telle quelle. Elle te rappelle celle-ci, très célèbre, de Deleuze, que Jean-Pascal avait fait figurer en exergue d’un de ses poèmes (citation des citations, tout est citation) : « Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. » Cela se trouve dans les Dialogues avec Claire Parnet, dont tu avais fait l’acquisition, tu t’en souviens très bien, à la librairie d’occasion de la rue des Charpentiers (l’établissement n’existe plus), un jour que l’orage roulait sur Strasbourg.
Il est l’heure de prendre un dernier Doliprane, histoire de bien enfoncer la fièvre. Tu penses au poème que les publicitaires de l’époque avaient rédigé pour vanter les effets des barbituriques que Raymond Roussel ingurgitait en doses colossales (citation retrouvée sur ton disque dur) :
Enfoncée la neurasthénie,
En France comme au Causase,
Par ceux qui prennent durant leur vie,
Le vrai sédatif ‘‘NEURINASE’’.
Vila-Matas parle assez peu de Roussel dans Paris ne finit jamais. Il y évoque cependant, non sans justesse, le « panthéon noir de la littérature : Lautréamont, Sade, Rimbaud, Jarry, Artaud, Roussel ». Je suis très heureux qu’il fasse signe à Jarry, auquel presque plus personne ne pense, et la constellation que signale Vila-Matas est plutôt très cohérente. J’en suis à un peu plus de la moitié du livre, et je crois que je ne vais pas tarder à interrompre ou abandonner la lecture de cet ouvrage pour attaquer Bartleby et compagnie, du même Vila-Matas : lectures gigognes de livres parlant de livres. Tu as subrepticement quitté la deuxième personne du singulier pour te rabattre, tout naturellement, sur le je, sans raison véritable, tu t’en rends compte alors que tu te relis, encore un peu fébrile.
Il n’y avait pas non plus nécessité absolue d’employer le « tu ». Simplement, l’énonciation s’est engagée de la sorte. Tu te sens moins fébrile, tout juste assez pour un peu prolonger la lecture de Paris ne finit jamais, et pour ne pas en finir la lecture.
Ce que tu cherches à comprendre, c’est le fonctionnement de Vila-Matas. Au fond, tu ne cherches pas à tout lire de lui, tu pressens même une perte de temps à cela. Tu alternes Vila-Matas avec d’autres lectures gigognes, qui t’emportent encore ailleurs, comme ce vieil exemplaire de Dylan Dog où il est question d’une momie assassine, ou encore le livre de Casey Rae sur l’influence de William Burroughs sur le rock ‘n’ roll. Tu essaies également d’avancer dans Les Princes de Francalanza, dont les dialogues t’épuisent presque autant que la fièvre.
Vila-Matas est, à l’évidence, un très grand lecteur, te dis-tu, reprenant Paris ne finit jamais après avoir somnolé sur le livre de De Roberto. Mais je ne suis pas persuadé que Vila-Matas mette réellement en place une biographie de la lecture, ou quoi que ce soit de cet ordre (irruption du « je », à nouveau, tu n’es décidément pas tout seul). Faire la biographie de la lecture n’a peut-être jamais effleuré l’esprit de Vila-Matas, du moins à la manière encore peu claire dont tu songes à cette approche de la lecture, à ce récit mi sensoriel mi existentiel (disons) de la lecture, et à la façon dont on pourrait en rendre compte.



