Time: the pressant.
(Finnegans Wake (221.17))
Avec son important travail sur le post-punk, Simon Reynolds s’était résolument tourné vers l’avenir fécond du « no future » (cf. Rip It Up and Start Again, 2005). Voici que le mouvement s’inverse : Reynolds s’intéresse au tropisme rétro dans la pop des années 2000-2010. Retromania (2011) envisage la Kulturindustrie non nécessairement comme un mauvais objet, tout en restant conscient des mises en garde d’Adorno et Horkheimer quant à cette forme massive et unifiée de la culture. L’ouvrage ne se veut pas une dénonciation directe de la tendance rétro en tant que régression ou décadence culturelle ; une écoute fine et dialectique de la pop est ici à l’œuvre, bien que quelque peu boulimique.
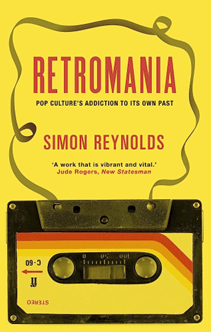
Une sensation de déjà vu ou de déjà entendu traverse la culture pop (cf. « L’éternel retour du même »). Exemplaire à cet égard, le morceau « Misirlou » immortalisé par Quentin Tarantino dans Pulp Fiction (1994), repris par Luc Besson dans sa saga Taxi (1999-2018) ou encore dans le jeu vidéo Rayman contre les Lapins crétins (2006). Or, Tarantino ne faisait alors que s’emparer d’un air folklorique grec enregistré pour la première fois en 1927, cristallisé à la grande époque du surf rock, successivement par Dick Dale (1962) et par The Beach Boys l’année suivante. Tout, à commencer par le cinéma de Tarantino, est toujours déjà de l’ordre de l’écho ; l’intertextualité et la « différance » règnent ; l’origine est égarée ; la postmodernité nous a habitué au succédané de tout.
Le phénomène rétromaniaque touche tous les domaines. Ainsi, Reynolds nous apprend qu’il existe une catégorie rétro de certaines pratiques dans la pornographie, comme en témoigne le retro face-sitting (sic). Reynolds dégage de grandes lignes de force quant à la culture en général, et c’est tout l’intérêt de son livre, mais Retromania s’intéresse principalement à la musique.
Premier constat : la première décennie 2000, les noughties sur quoi porte ici l’intérêt, fut marquée par une sorte de ralentissement du temps, par une lenteur toute particulière avec laquelle cette époque tendait à progresser. Partant, Reynolds interroge notre nostalgie : « La nostalgie empêche-t-elle notre culture d’aller de l’avant, ou alors sommes-nous nostalgiques précisément parce que notre culture a cessé d’aller de l’avant et que nous regardons inévitablement derrière nous, en quête d’époques plus vives et plus dynamiques ? » (je traduis — l’ouvrage a paru en France aux excellentes éditions Le Mot et le reste en 2012, Jean-François Caro trad.). Et, de manière plus inquiétante : « Mais qu’adviendra-t-il lorsque nous aurons écoulé notre stock de passé ? Foncerons-nous tête baissée vers une sorte de catastrophe culturelle/écologique, une fois que le filon historique de la pop aura été complètement exploité ? […] De quoi se nourriront les lubies nostalgiques et les engouements rétro de demain ? »
Reynolds avance que les années 60 sont des années sans nostalgie. La nostalgie, précisément, que l’on peut éprouver pour cette période sans nostalgie, qu’on l’ait vécue ou non ne change rien à l’affaire, est sans doute liée à cela. Il est un « esprit d’immersion dans le présent » dont on n’arrive plus guère à faire l’expérience aujourd’hui, puisque le présent nous est devenu, selon Reynolds, un « pays étranger ». Sans doute que cette obsession pour le passé est liée à l’état réputé idéal de l’enfance, croyance confortée, comme le rappelle Susan Neiman, par une société qui vise à nous installer dans ce paradis infantile et à nous y maintenir. Ainsi, le syndrome de Harry Potter est-il devenu le nouveau syndrome de Peter Pan ; peut-être est-il plus insidieux encore, car le jeune sorcier grandit, s’adapte à la béatitude de ses consommateurs. Pareillement, dans le domaine de la musique, Michael Jackson, pris très tôt en charge par le spectacle, eut le succès planétaire que l’on sait.

Il y a bien quelque chose de ridicule aux multiples consécrations commémoratives du rock, au fétichisme lié à la musique. Or, la vérité est là : « Le rock est désormais assez ancien et établi en tant que forme artistique pour donner lieu à sa propre industrie muséale. » Des musées comme le British Music Experience (Liverpool) domestiquent le rock, le rendant ainsi inoffensif. « L’ancienne guerre Old Wave/New Wave est devenue histoire antédiluvienne, et c’est précisément le but du musée du rock que de présenter la musique tout en effaçant ses lignes de front, étouffant tout cela dans un drap douillet d’acceptation et d’assentiment. » Pour Adorno, le musée c’est le mausolée, comme le rappelle Reynolds à fort juste titre. Mais sa méditation sur la commémoration du rock questionne également l’archive de celui-ci, convoquant au passage le « mal d’archive » selon Derrida. Dans une mémoire qu’il convient de qualifier de démentielle — celle de notre temps —, la fièvre accumulatrice dépasse tout contrôle, menaçant de faire s’écrouler tout l’édifice de l’archive. « L’histoire, signale Reynolds, doit bénéficier d’une poubelle, ou alors elle deviendra elle-même une poubelle, une gigantesque poubelle débordant de déchets. »
Retromania est essentiellement le livre d’un collectionneur de disques, d’un spécialiste de la musique qui accumule, pour des raisons peut-être aussi obsessionnelles que professionnelles, les objets liés à sa passion. On sera tantôt amusé ou agacé par cet aspect de l’esprit de Reynolds. Pour peu que l’on ne soit pas spécialisé dans cette culture de la marge au sein même de la culture de masse, on se sentira submergé par la connaissance qu’a Reynolds de son sujet. L’auteur tâche cependant d’effectuer son autocritique en proposant une analytique de la collection, qui s’appuie notamment, et sans surprise, sur Benjamin et Baudrillard, mais aussi sur le On Longing de Susan Stewart et sur le To Have and To Hold de Philipp Blom [Une histoire intime des collectionneurs] ainsi que sur la propre pratique de la collection de Reynolds, ou encore sur la collection de cartes Pokémon de son fils.
L’ouvrage regorge de micro-études consacrées à de petits groupes ou artistes quelquefois obscurs, dont on découvrira l’existence grâce à Internet. Ainsi, l’incroyable John Oswald et son Plunderphonics.
Le rétro travaille aussi sur le mode du shuffle et cet exemple de mash up n’est pas sans annoncer les YouTube poops. Peut-être que l’ « iconoclasme digital » perpétré par Oswald réinjecte une sorte de vie à la pop de Jackson, pulvérisant « Bad », en en proposant l’anagramme sonore (et visuelle). Dans cette perspective, Reynolds consacre d’importants développements à l’unité de l’œuvre, à sa continuité, dans la saturation informationnelle propre à notre époque.
Un important chapitre de Retromania est consacré à la musique et à sa mémoire à l’ère de YouTube. « Chaque minute, l’équivalent de vingt-quatre heures de vidéos est mis en ligne, et il faudrait quelque 1 700 ans à un seul usager de Youtube pour visionner les centaines de millions de vidéos que comprend le site. » Reynolds écrivait cela en 2010. On estime aujourd’hui que 300 heures de vidéos seraient mises en ligne sur la célèbre plateforme chaque minute, soit la bagatelle de trois semaines à la minute, l’ensemble des vidéos comprises sur le site, dont le nombre ne cesse d’augmenter, représentant plus de 17 810 années de visionnage [voir ici]. Bien entendu, cela a un impact sur les ventes de disques et sur la manière dont nous consommons de la musique. À quoi s’ajoute ou se greffe une stratégie commerciale dite de longue traîne, renforcée notamment par les pratiques d’Amazon, laquelle modifie tout aussi grandement nos pratiques culturelles.
Reynolds revient également sur l’usage du MP3, qui facilite l’accumulation des données : la mémoire musicale est donc là encore bouleversée, quantitativement autant que qualitativement. L’avènement du CD, au milieu des années 80, fut également d’une grande importance dans ce processus; pouvoir sauter aisément d’une plage à une autre par l’usage d’une télécommande avait déjà commencé de faire de nous des consommateurs digitaux adeptes du zapping audio, de l’écoute fragmentée sinon fragmentaire.
Dans l’ « l’anarchive labyrinthique » de YouTube, la notion même d’ennui a été modifiée : la pléthore et l’immédiateté de tout à n’importe quel instant ont remplacé l’attente de l’événement unique (et qu’est devenu, au juste, un événement à l’ère numérique ?) : « L’ennui d’aujourd’hui ne repose plus sur la faim ni n’est une réaction à quelque privation que ce soit ; il est une perte d’appétit culturel, en réaction à une surabondance de sollicitations qui portent autant sur votre attention que sur votre temps. » Corrélativement à cela, cette autre question : la culture est-elle à même de survivre dans un pareil espace sans limites ? En cela que « l’intérêt des voyages temporels permis par YouTube et Internet en général ne se situe pas dans le passé. Ce sont des voyages de côté, latéralement, à la surface d’un espace-temps archivistique. » Fin, donc, de la profondeur et de l’angoissante chute dans le temps : avènement irrémédiable de la surface, pour le meilleur et pour le pire.



