Au bord du Volcan (1)
« … if I only knew how to begin. »
(Alice in Wonderland)
Je prends ici le parti de me tenir au bord du Volcan. Ce sera là, pour idéalement débuter, une parole inchoative qui vise à questionner le comment du commencement, dans une sorte de bégaiement éperdu. Tant le texte de Malcolm Lowry nous exhorte à l’impossible.
Il est des romans qui résistent à la lecture, et sans doute sont-ils faits pour cela (pour cela, oui, mais pas seulement à cette fin, de loin pas), et dont tout pourtant conspire à ce que l’on y persévère, de sorte à y trouver une voie praticable. Exemplaire en cela, Under the Volcano (1947) de Lowry — Sous, ou Au-dessous du Volcan, cela dépend de la traduction.
Ces romans ressortissent à la jouissance, pour reprendre la terminologie célèbre de Roland Barthes dans Le Plaisir du texte (1973) : « Texte de jouissance : celui qui met en état de perte, celui qui déconforte (peut-être jusqu’à un certain ennui), fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques, du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage. » Peut-être pourrions-nous, à l’endroit du Volcan, questionner la jouissance en des termes plus serrés, plus proches de la psychanalyse (domaine où Barthes, du reste, est allé chercher cette notion). Je tâcherai de déplier cette intuition plus tard.
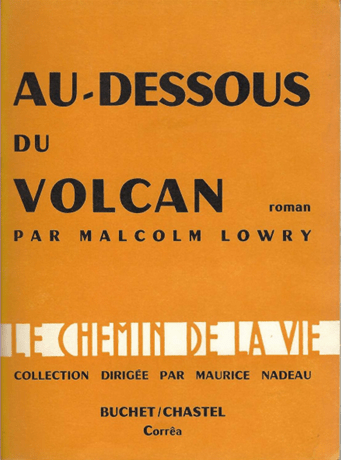
Les scholars, les lecteurs professionnels de Lowry, sont toujours utiles pour éclaircir tel ou tel point de détail. L’effet de pareilles approches est néanmoins limité. Car il ne s’agit pas seulement d’expliciter. Ce serait par trop simple. La jouissance du texte en appelle à tout autre chose. Selon les termes mêmes, combien touchants, de Lowry : de l’écriture de son roman, il en a fait l’expérience.
On ne se méfiera jamais assez du discours émanant de l’auteur, entité peu fiable, hâbleuse souvent, à quoi correspond l’arcane ambigu du Bateleur au tarot (non moins inscrutable, l’arcane du Consul serait peut-être l’arcane sans chiffre, Le Mat, suivi de son « chien paria »). Mais une incroyable charge existentielle n’en anime pas moins la machine romanesque de Lowry, laquelle fonctionne et déconne, déconne à mesure qu’elle fonctionne, comme si elle était directement branchée sur le système nerveux passablement abîmé de notre écrivain.
Cela relève du sensible. Cela sent, comme on dit, le vécu. Ce n’est pas du chiqué à la Cendrars, du pipeau à la Faulkner. La jouissance et l’authenticité de Lowry sont celles d’un Joseph Conrad, d’un Jack London, d’un Jack Kerouac, ou encore d’un Dylan Thomas. Le passage souvent cité (à commencer par Lowry lui-même) en atteste, de la longue lettre apologétique de Lowry à son éditeur Jonathan Cape. On croit Lowry sur parole :
Le roman peut être abordé comme un simple récit dont on sautera certains passages à son gré, ou comme un récit d’autant plus profitable qu’on ne sautera rien. Il peut aussi être abordé comme une sorte de symphonie, ou encore un opéra — voire un soap opera de cow-boys. C’est une musique syncopée, un poème, une chanson, une tragédie, une comédie, une farce, etc. Il est superficiel, profond, divertissant et ennuyeux selon les goûts. C’est une prophétie, une mise en garde politique, un cryptogramme, un film grotesque et un graffiti sur un mur. On peut même l’envisager comme une sorte de machine : ça marche aussi, vous pouvez me croire, j’en ai fait les frais. (Malcolm Lowry, Merci infiniment (Allia, 2010)).
D’un roman comme le Volcan, il ne saurait y avoir de lectures que profondément hétérodoxes, lesquelles visent à traverser l’œuvre, dessinant un chemin presque aussi périlleux que l’œuvre elle-même. Que l’on songe, par exemple, à Georges Perec lisant Malcolm Lowry, avec au-dessus de lui une carte marine, un portulan — cela aboutira à un autre très grand livre, bien différent de celui de Lowry, dont on n’a sans doute pas encore complètement mesuré l’ampleur, La Vie mode d’emploi. C’est dire combien Lowry est un writers’ writer, un écrivain pour écrivains, une sorte d’écrivain au carré, façon Joyce ou Proust.
Lowry est également présent dans les grands livres de Gilles Deleuze, où il est superbement recyclé, mais Clément Rosset en fait un usage au moins aussi éclairant dans Le Réel. Traité de l’idiotie (1977). Rosset étudie les déambulations du Consul, colossal ivrogne. En émerge l’axiome suivant : « Indétermination totale et détermination totale sont à jamais confondues l’une avec l’autre. » J’y reviendrai. Sans doute est-ce la clef du pathos de ce roman qui fait se confondre hasard et nécessité, ligne droite à jamais perdue et circularité infernale. Nous sommes bien entendu chez Dante, Lowry ayant projeté, ni plus ni moins, d’écrire une « Divine Comédie ivre » dont le Volcan n’est en somme que l’Enfer. Lowry avait prévu d’écrire une suite au Volcan, le tout formant une sorte de saga romanesque qui se serait intitulée The Voyage that Never Ends. Peu importe au fond que Lowry soit parvenu ou non à ses fins. Ce voyage qui n’en finit pas n’est autre que celui de notre lecture-vie du Volcan (on y passe aisément une grande part de son existence — de la lecture considérée comme une macération). Or, celle-ci est, je crois, invariablement marquée par une sorte de bégaiement, de reprise initiale.
Lowry n’a que peu d’égards pour ses lecteurs et lectrices. Le premier chapitre du Volcan est d’une difficulté telle que l’on abandonne souvent le livre passé dix pages. Le roman débute sur un superbe abrupt :
Deux chaînes de montagnes traversent la république du nord au sud à peu près, qui ménagent entre elles nombre de vallées et de plateaux. En contre-haut d’une de ces vallées que dominent deux volcans s’étend, à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville de Quauhnahuac. Elle se trouve bien au sud du Tropique du Cancer, pour être exact sur le 19e parallèle, presque à la même latitude qu’à l’ouest, dans le Pacifique, les Iles Revilla Gigedo ou, beaucoup plus à l’ouest, la pointe la plus méridionale d’Hawaï, et à l’est le port de Tzucox sur le rivage atlantique du Yucatan, près de la frontière du Honduras Britannique ou, beaucoup plus à l’est, la ville de Jaggernath, aux Indes, sur le Golfe du Bengale. (Stephen Spriel trad., avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur — j’emploie cette traduction, qui est la plus courante).
Le paragraphe que je viens de citer, il faut le lire avec un globe terrestre à portée de main, et en suivre du doigt les indications géographiques. On commence ainsi à mieux saisir qu’il s’agit, ni plus ni moins, d’un roman-monde sous la forme d’un voyage sans fin. Aussi simple que cela.
D’emblée, dès le premier paragraphe du Volcan, Lowry, d’un bout à l’autre du monde, nous promène. La ville de Quauhnahuac est une invention à partir de celle, bien réelle, de Cuernavaca. Les différents toponymes employés dans cette ouverture très aride sont éminemment exotiques et participent d’un ancrage peut-être plus mythique que géographique. La mythopoièse agit en priorité dans l’espace donné du Volcan. Ainsi, dans ce premier paragraphe, la référence à Hawaï renvoie éminemment au fait qu’Yvonne, l’ex-épouse du Consul soit née sur cette île, bien que cette information ne nous soit dévoilée qu’au chapitre suivant (comme chez Conrad, il est question chez Lowry d’un constant « décodage différé » (Ian Watt)). Si le Tropique du Cancer est une allusion possible au roman de Henry Miller (mémorable paragraphe d’ouverture, là encore, et bien dans le ton de Lowry : « We are all alone here and we are dead. »), la référence, non moins tragique, à la ville de « Jaggernath » — elle réapparaît au chapitre 6 du Volcan — marque l’inéluctabilité du roman de Lowry. En vertu du colonialisme britannique, le vocable « juggernauth » a été adopté, dans son acception métaphorique, par la langue anglaise dès la première moitié du dix-neuvième siècle ; il renvoie à un char sacré qui, quelquefois, écrase les pèlerins se jetant sous ses roues. Juggernauth est aussi le « Seigneur de l’Univers », titre souvent attribué à Krishna. On apprendra, dans ce chapitre premier, que le Consul est né en Inde. Une étrange formule du Consul semble faire écho à cela lorsqu’au début du chapitre 3 il évoque le jardin d’Yvonne laissé à l’abandon : « a rajah mess », dont la traduction est plutôt faible ici : « un royal fouillis » (rajah étant un titre de noblesse en Inde). Le jardin idéal d’Yvonne et du Consul (leur union) est donc contenu in nuce dans le premier paragraphe du Volcan. Les derniers mots du roman, après même que tout soit dit, évoquant précisément cet autre jardin, qui apparaît au chapitre 7 :
¿LE GUSTA ESTE JARDIN?
¿QUE ES SUYO?
¡EVITE QUE SUS HIJOS LO DESTRUYAN!
Mais je vais trop vite. Si la tragédie est anticipée dès le premier paragraphe du roman, le premier chapitre n’offre en réalité que peu de plaisir à la première lecture (redisons-le, c’est de jouissance dont il s’agit). Retenons simplement que ce premier chapitre se déroule un an exactement après l’action véritable du roman, lors du Jour des Morts de novembre 1939. Ce premier chapitre est donc une sorte d’épilogue. Le roman de Lowry est monté à l’envers, et on ne peut le lire qu’à reculons… ou tête en bas. L’épisode au chapitre 7 du Consul pété comme un coing (« dans un état d’ébriété à vrai dire exceptionnel ») bringuebalé dans un manège de fête foraine, La Máquina Infernal, semble nous y encourager : « Le Consul, comme ce pauvre idiot qui apportait la lumière au monde, demeurait la tête en bas… » Toujours est-il qu’à l’issue du premier chapitre, la grande roue foraine tourne à l’envers, pour mieux annoncer le retour en arrière d’un an au chapitre suivant.
Le premier chapitre du Volcan, pour ardu qu’il soit, doit être lu en priorité, et avec davantage d’attention peut-être que le reste du roman. Sa signification n’éclot que par la suite, à la lumière des onze chapitres suivants. Et ceux-ci ne tiennent à vrai dire pas, sans cet exigeant épilogue préliminaire. La longue lettre du Consul à Yvonne (à la fin du chapitre), par exemple, garantit la profondeur du roman, et l’arrivée d’Yvonne, au deuxième chapitre, n’en est que plus dramatique. Le premier chapitre enfonce le récit dans une durée indicible : « Ce qui s’était passé il y avait juste un an aujourd’hui paraissait déjà d’une autre ère. L’on eût cru que cela se perdrait comme une goutte d’eau dans les horreurs du présent. Il n’en allait pas de la sorte. » Ce faisant, il permet d’annoncer de manière fine et subtile les grands motifs du roman : le jardin de tous les symboles, la roue du Temps, ou encore le « No se puede vivir sin amar » que le Consul inscrivit sur le mur de son ami Laruelle, etc. La charge existentielle ou émotive du roman — son pathos — est amplifiée par ce regard rétrospectif sur le jour des morts, tel qu’il se déroula en 1938 à Quauhnahuac.



