pour Antonio Malatesta
Dans quelle mesure la poésie doit-elle ajouter quelque chose au monde ? N’est-ce pas une des vanités constitutives du poème que de se présenter comme un supplément définitif à ce qui est, alors même que le poème n’est guère qu’un dérivatif plaisant (approche bourgeoise), un cataplasme à ma peine (approche adolescente ou romantique), au mieux un supplétif dérisoire (approche réaliste-cynique) ? Qui suis-je pour trouver à redire quant aux choses qui, de toute éternité, sont là, et là sans moi, qui n’ont pas attendu, pour exister, que ma parole vienne peser sur elles ?
Ce n’est pas sérieux.
Nathaniel Rudavsky-Brody œuvre dans le retranchement. Poésie en taille-douce, dirait le graveur. Ce travail du négatif, de la parole qui soustrait et se soustrait est sans doute plus proche de la pratique du Zazen que de Hegel. (Que serait, au juste, une poésie hégélienne ? Une monstruosité, il va sans dire.)
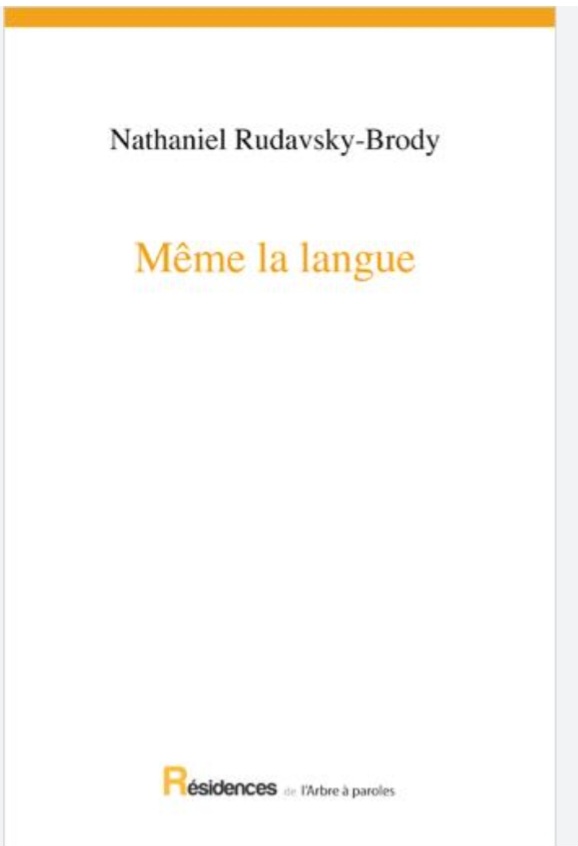
La plaquette Même la langue (L’Arbre à paroles, 2012) consiste en une série de souhaits conjuratoires, formulés sur le modèle du « Qu’il n’y ait plus… ». Ces vœux négatifs extirpent le monde de sa gangue, de ses inutiles scolies et scories.
Que tu n’aies plus besoin de t’expliquer,
non pas que les hommes commencent à te croire,
mais qu’il n’y ait plus de croyance,
que les images, puis les mots, n’aient plus de sens
pour ceux qui ne les ont pas vus, ni trouvés
dans les tiroirs de l’esprit […]
Mais de ce processus d’épargne surgit une tentation d’exister. Cette réduction serait l’essentiel du poème, un retour à un âge d’or enfantin.
[…] et que les hommes se retrouvent tout simplement
face à face, leurs souvenirs d’enfance et
les histoires qu’ils racontent et se racontent
redevenus des vieilles promesses
imprimées sur les briques de lait de leur enfance
La soustraction dessine ici le premier temps d’un recueillement. Retour utopique, impossible nostos, aux rives d’une parole qui soit pleine, ou alors naufrage pur et simple, échouage conscient du poème sur les récifs d’une parole autre, irréductiblement étrangère. Il faut imaginer Ulysse arrivant chez les Phéaciens. Naufrage agréable, dont on souhaite qu’il dure toujours, séjour sans idée de départ.
Et voici le deuxième temps du poème de Rudavsky-Brody, celui qui affirme une escale éternelle :
et au port,
plus de bateaux,
et en mer,
plus de bateaux,
et parcourant les
canaux poisseux,
plus de bateaux,
et dans les bouteilles
et sur le lac le soir,
plus de bateaux.
La question d’un lieu — mettons, l’île d’Alkinoos — s’énonce en-deçà de tout savoir, de toute parole même. Les briques de lait de l’enfance dont il était question il y a un instant touchent à l’ineffable d’une parole infans — autre état du poème, qui serait toujours en train de naître à son langage. Partant, Rudavsky-Brody vise à délester son poème de quelques certitudes accumulées dans nos savantes bibliographies.
et en soi, plus de ces mystères
qu’un vieux livre, détenteur
d’un savoir désuet et donc
merveilleux, ne pourrait résoudre,
même réduit à quelques
notes de bas de pages fugaces, le
dernier refuge de l’esprit,
où il n’existe
que cité (titre, auteur, ville de
l’éditeur) mais pourtant n’explique
pas moins tous
nos doutes infondés
Tout à l’heure, je posais la question du « qui suis-je ? ». Rudavsky-Brody est le traducteur, en langue anglaise, de Benjamin Fondane et de Paul Valéry. De ce dernier, on peut songer à l’Hélène, qui demande « qu’y suis-je ? ». Cette interrogation n’est pas sans hanter le lecteur de Rudavsky-Brody.

Naufrage, rivage impossible, retour par et dans le négatif, bateaux abolis — le poète écrit avec le silence pour horizon. La quête du refuge étrange du « qu’y suis-je ? », celui d’une énonciation à même les ruines, se poursuit avec En lieu de silence (Le Cormier, 2018). On assiste, dans ce deuxième recueil, à une forme d’entassement des mots, mais on ne saurait dire s’ils remontent ou s’ils descendent la pente du silence.
Il faut aller y voir. C’est plus sérieux qu’on pourrait le penser.



