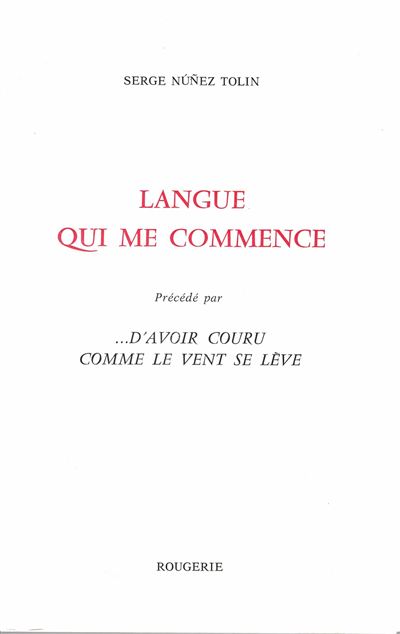
C’est un parler pour. Non pas une adresse seulement. C’est davantage qu’une adresse. Le parler pour de Serge Núñez Tolin est un parler dans ainsi qu’un parler sans. Le parler pour est une prière ou une louange dûment et expressément adressée, mais ce n’est pas cet aspect — évident et touchant, touchant par son évidence même — que je vais souligner ici. Ce serait redire, et trop platement, ce que dit le livre de Núñez Tolin.
Parler pour les sensations, pour les travaux et pour les jours, pour nos présences quotidiennes, les gestes banals : la simple tâche d’être ici.
Núñez Tolin maintient la poésie dans un état d’infans, dans l’enfance de la langue, qui est son « préalable », et peut-être son horizon. L’infans est le sans parole. Et, précisément, Núñez Tolin parle pour les analphabètes, comme Artaud (Deleuze le rappelle avec justesse). Ce n’est pas tant s’adresser aux analphabètes, pas seulement, mais plutôt parler au nom d’eux, pour eux, à leur place, qu’ils soient présents ou absents. C’est parler en leur absence même. Pour eux. Et l’Analphabète, l’absent de la langue et son primum mobile, n’est autre que Pedro Núñez Ríos, l’Abuelo, le grand-père du poète.
Car cet ouvrage de Núñez Tolin fonctionne comme un poème à clefs, où l’auteur se livre sans ambages. Foin du mystère de la poésie, de sa bagatelle mystique, de ses ombres spécieuses. On laissera cela à ceux qui aiment à s’y pâmer, à s’y perdre. L’enjeu de la parole de Núñez Tolin, de son parler pour, est tout autre. Combien plus modeste.
Le parler pour est une remontée aux origines : « Mots après mots, je remontais son silence. » Aux origines du silence (Núñez Tolin est un faux silentiaire), le poète est parti en quête du « soulèvement des choses dans l’usage des mots ». L’écriture des « choses simples », oui. Mais, ajoute Núñez Tolin, « où les contraires se coudoient ».
Choses simples où les contraires se coudoient.
Le poème, appelé ailleurs « exercice du silence », aboutit à une sorte de nœud de communication : « l’écoute est parlée, elle a trouvé sa langue. » Cela résonne à la manière du « c’est fait j’ai fait l’image » de Beckett. Une sorte d’Eurêka, mais de soulagement. Pour autant, les silences de Núñez Tolin ne sont pas de la même nature que ceux de Beckett. Le méthodique harassement de ce dernier ne saurait se confondre avec le sincère abrasement de Núñez Tolin.
J’ai évoqué Artaud, Beckett, Deleuze même. Ce sont de grands noms, bien connus, usés, galvaudés par un bon demi-siècle de glose, de béatitude universitaire (on a consacré un mémoire de Master à Núñez Tolin, la consécration est à venir…). Les comparaisons ne tiennent à vrai dire pas avec ces écritures. C’est vers François Jacqmin qu’il faut aller pour établir une analogie plus juste avec Núñez Tolin. On le lit moins, il est vrai.
Lorsqu’on œuvre avec le parler pour, il faut « faire confiance au vide ». En témoigne une béance qui serait l’essentiel Abgrund, l’absence de sol, le sans-fond où le poème ne manque pas de s’ancrer.
Il y a un trou où le sol manque.
Partant, il faut oser « le récit d’une langue à soi ». Une langue à soi quand celui qui nous a précédés n’avait pas les mots — voici l’enjeu du parler pour.
Voir mon entretien avec SNT : première partie & deuxième partie. Voir également : L’Exercice du silence.



