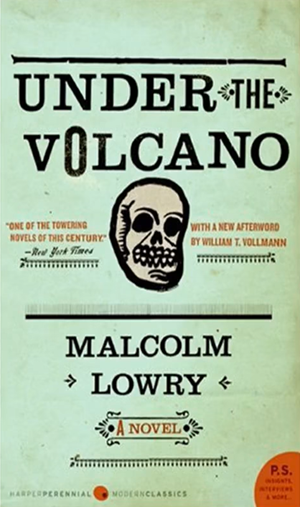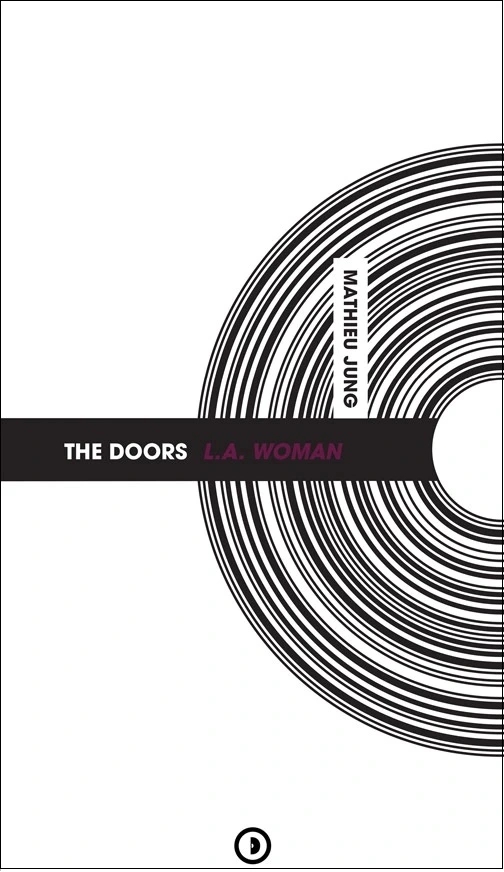Mathieu Jung — Tu viens de publier un ouvrage au Cadran Ligné, intitulé L’Immobilité et un brin d’herbe. Celui-ci me semble faire suite à L’Exercice du silence, toujours au Cadran Ligné (2020). Je dirais que ces recueils œuvrent tous deux — chacun, ou alors ensemble — autour d’un noyau, peut-être « infracassable » et de « nuit », comme dirait André Breton. L’immobilité et un brin d’herbe est placé sous l’égide de Joe Bousquet. De fait, la formule « traduit du silence » me semble idéalement convenir à ton travail poétique, explicitement dans L’Exercice du silence, mais de manière peut-être un peu différente dans L’immobilité et un brin d’herbe. Ma question veut donc porter sur la continuité ou, au contraire, sur la rupture d’un livre à l’autre.
Serge Núñez Tolin — L’exercice du silence (10 août 2004 – 02 juin 2005) précède en effet L’immobilité et un brin d’herbe (22 décembre 2005 – 27 juillet 2006). Entre les deux : Sur le fil de la présence (02 juin 2005 – 22 décembre 2005) qui paraîtra, au plus tard, avant juin 2024 aux éditions Le Taillis pré. L’écriture est donc sans rupture entre le 10 août 2004 et le 27 juillet 2006 enchaînant sans discontinuer entre ces trois titres.
À vrai dire, il en est ainsi, au moins de façon attestée, depuis février 2001 jusqu’à ce jour de 2024. Soit depuis la rédaction de Silo II et Silo III parus aux éditions Le Cormier (2002 et 2003). Actuellement, un tiers de mes livres est paru. (C’est bien la première fois que je livre ceci publiquement.)
Il y a bien, ici et là, entre un titre et le suivant, des périodes de crise durant lesquelles l’écriture s’absente, sans toujours décider si la crise provient du fait du retrait des mots ou découle d’un retrait de vitalité dû à la chiennerie de la vie (dont, à ce jour, je serais malhonnête de me plaindre).
Toujours est-il que comme Jacques Vandenschrick (Le Cheyne éditeur) a parfaitement qualifié les choses, je serais un diariste. L’écriture accompagne la vie. Dans ce pas-à-pas, l’une va de pair avec l’autre. La vie précède. L’écriture suit et tente d’élucider celle-ci. Toutefois, bien que je ne puisse m’en défaire, les mots m’apparaissent si souvent impuissants ou insuffisants.
Par ailleurs, bien qu’à se retourner sur l’œuvre, il n’y paraisse pas, j’avance sans intention préalable, du premier mot à ce jour. Le noyau « infracassable » des choses et la « nuit » dans laquelle nous sommes circonscrivent pour moi les données de notre présence au monde. Aussi, tout auteur et créateur que je serais, je décide peu. Tout s’écrit depuis un lieu que j’ignore, qui est la vie, mon corps et le monde. Ici et maintenant, sans transcendance aucune. Dans un tel contexte, je ne crois pas davantage que l’écriture soit la dernière transcendance restante. Ce serait dérisoire !
Rien dans tout cela pour rendre malheureux. Il y a les autres, le tutoiement choisi, à ses divers degrés d’incandescence. Il y a la nature et ses paysages, la marche. La vie qui nous est échue, le monde sous nos sens. Il y a aussi la lutte sociale, la lutte pour la vie, celles pour la justice et l’équité et la splendeur incroyable de quelques-unes de nos réalisations, matérielles ou dans l’ordre des idées. L’humain est un producteur de sens, quand bien même il voudrait n’en pas produire. Et nous en aurions des raisons de ne rien produire…
Nous pourrions revenir ultérieurement à Joe Bousquet, aux Surréalistes … (26 mars 2024)
M. J. — En réaction à ta première réponse, me vient une interrogation. Les dates semblent revêtir une grande importance dans ton travail. Peut-on qualifier celui-ci de journal poétique ? Cet ancrage temporel paraît en tout cas singulier dans ton approche. Est-ce une manière de travailler ou de prendre acte, « présentement », de la présence ?
S. N. T. — J’écrirais, sans doute, un Journal en poésie !? Oui, c’est en ce sens qu’il est juste de parler de diariste. Est-il vrai que Freud aurait dit qu’une vie non psychanalysée ne serait pas une vie vécue ? Quoiqu’il en soit et toutes choses n’étant pas égales, à commencer par celui que je tente d’être et celui que Sigmund Freud fut et reste encore, je paraphraserais cette hypothèse, en la transposant pour les besoins de ma réponse, comme suit : une vie qui n’est pas écrite ne serait pas une vie vécue. À tout le moins, une vie de poète. Celui que je tente d’être.
Et si j’écris, c’est sans manquer de penser l’écriture elle-même. Comme je vis, c’est sans manquer de penser la vie elle-même. C’est un concert régulier avec les mots, quotidien, qui m’aura conduit jusqu’ici.
Il est remarquable, enfin, plus simplement, je veux dire que je remarque combien cette attention portée à la vie par le moyen des mots va, forcément, de pair avec l’examen de la puissance des mots au moyen des mots eux-mêmes.
Ensuite, par souci d’authenticité, je dois dire que je ne crois pas avoir conduit les mots qui, véritablement, me sont venus. Je me suis laissé conduire serait plus exact quant à ma démarche.
Mais que l’on me comprenne, lorsque je prétends que « les mots me sont venus », je ne postule pas une transcendance, quelle qu’elle soit, d’où je tiendrais la poésie que j’écris. Je le dis de cette façon car je dois bien constater pour moi-même que mon écriture si elle (se) pense, n’est pas pensée au préalable par moi. Pas d’intention d’écrire, sinon la feuille blanche et, sur la table de peine, les livres de ceux avec qui j’entre en dialogue, souvent la poésie en vivo, d’auteurs contemporains. Je tends alors à une disponibilité, disons orientale ( !) ou mystique ( !). C’est une concentration de l’esprit parvenu à s’oublier, une sorte d’état de conscience autre dont le flux peut enfin se libérer. Et il arrive alors que j’écrive.
J’essaye donc au moment d’écrire, cette sorte d’absence où l’on est tout à soi-même dans le monde, à savoir, dans un présent de la présence, comme tu le dis dans ta question, bien justement !
Pour me faire mieux comprendre et partager avec tous ce que l’on peut dire de cet état particulier de la conscience, j’évoque souvent la joie. Celle qui lorsqu’elle survient, prenant tout notre être dans sa surprise, nous empêche de la reconnaître de l’extérieur car nous sommes tout entièrement en elle. Nous vivons son présent (la temporalité, comme le cadeau qu’elle est) immergés en elle.
C’est au point que tout occupé à la vivre, on ne se voit pas la vivant. Ce ne sera qu’après, parfois longtemps après, que l’on comprendra l’avoir vécue et ces instants miraculeux deviennent alors le point de notre éternel retour. Ainsi en va-t-il de l’écriture qui dans la banalité de la série des jours n’est pas, en soi, nécessairement joyeuse.
Pour finir, par un aspect concret, le lecteur aura prêté attention au fait qu’à la place du mot « Fin » à la dernière page, à la suspension des mots, on lit systématiquement deux dates. Celle de début de rédaction et celle de fin. Au gré des circonstances éditoriales, des livres paraissent qui se suivent. Puis-je espérer qu’il en paraîtra suffisamment pour que l’on puisse rétablir au travers du désordre des parutions, l’ordre chronologique de rédaction ? On pourra s’apercevoir alors que l’écriture n’a pas de fin. Ou pour le dire de manière plus approchante, l’écriture est une continuité qui s’avance avec la banale succession des jours. C’est ce que j’appelle « le voyage de l’œuvre », si ce n’est comme la vie. (09.04.2024)
M. J. — Reprends-moi si je me trompe, mais est-ce que cette écriture à ras du monde ou de la vie procède de cet état particulier dans lequel Artaud dit se trouver dans une lettre à Jacques Rivière, à savoir, « en disponibilité de poésie » ? Cette formule a quelque chose de saisissant, en cela qu’elle apparaît au seuil de l’œuvre d’Artaud (7 mai 1924), et ton écriture ressortit, elle aussi, de l’inchoatif ; elle dit, modalise ou mime un éternel début, c’est aussi bien en cela qu’elle n’a pas de fin. Peu importent, au fond, les bornes que procurent les dates : cet interminable début que je crois cerner chez toi serait un épanouissement parallèle, ou tout juste tangent au temps qui va, plus proche de la durée que du temps conventionnel des horloges. Pour tâcher de me faire mieux comprendre, ta parole valant sans doute davantage que la mienne, je cite L’immobilité et un brin d’herbe où s’esquisse l’ « intuition d’un matin capable d’autres matins ».
S. N. T. — Cher Mathieu, merci pour la date antonine du 7 mai 1924 : « tu as mis le doigt sur un côté de moi-même » ! Pour te faire suite, je m’autorise de ce que tu t’es appuyé sur une citation pour m’en retourner aussi vers mon texte. En l’occurrence, ce sont des extraits d’inédits. Et je suis très touché que tu places, comme un moteur de l’écriture autant que de l’être, les notions de commencement et de départ. Délogeant, en effet, le temps conventionnel du cadran de la montre, je tente de les placer dans la chair du corps et dans leur quotidien le plus trivial. Manière d’acception lucide de l’Absurde, seule majuscule admise ici :



M. J. — J’aimerais interroger la forme que prend ton écriture. Dans L’Immobilité et un brin d’herbe, tu évoques l’île, qui me paraît faire signe à quelque mise en archipel de la parole sinon de l’être :
Mots incapables de poser l’île intérieure dehors.
Dans la violence silencieuse des choses : l’île intérieure.
Tu affectionnes la forme brève, l’île ou, disons l’isolat. Mais quelle est la nature de cette brièveté ? S’agit-il de fragments ? Est-ce que ces manières d’aphorismes ou d’apophtegmes placés en archipel ne relèvent pas aussi bien de brisures ou de brisées ? D’éclats appartenant à quelque chose de plus grand ? Pour prolonger la géographie maritime et rêveuse, nous pouvons tout aussi bien évoquer la figure de l’isthme, autre image subjective du poète, présente elle aussi dans ce recueil :
Est-ce pourquoi je suis l’isthme d’un corps bordé de part et d’autre par un vertige sans mots ?
S. N. T. — En manière de préambule, je commencerais par dire que, dès le début de l’écriture, je n’ai pas eu à répondre aux questions de forme. Très simplement, parce que dès le commencement, jusqu’à aujourd’hui, je ne me suis pas posé ces questions. J’ai écrit assez tôt avec la seule conviction que cela devait être comme c’était, selon la spontanéité de la venue sur la feuille. La forme en prose est venue simultanément avec les mots à la suite de paragraphes justifiés uniformément entre les marges. Suivre le flux d’une conscience abritée de la ratio, tenue dans une disponibilité et une vacance nourricières.
Aussi, quelle n’est pas ma surprise quand je me vois interrogé sur la présence de formes brèves, d’îles, d’aphorismes ou d’apophtegmes (par exemple : « L’immobilité n’est pas un puits sec. » ), d’éclats ou d’isolats ? Je qualifie l’écriture dont j’accompagne ma vie comme « le voyage de l’œuvre », l’un étant le voyage de l’autre, dans tous les sens.
Cette nappe de mots dans la succession des jours n’est qu’un écho banal du temps. Et, en effet, les fragments que l’on retrouve ici et là, depuis toujours jusqu’à maintenant, correspondent sans doute à quelque chose, au-delà du penchant que j’ai pour ces apparitions. Toutefois, si, comme tu l’écris, il s’agissait « d’éclats appartenant à quelque chose de plus grand » ce ne serait pas une transcendance quelle qu’elle soit. Cela je l’ai déjà dit. Mais il est vrai que, dès le début, les livres parus entre 2001 et 2006 aux éditions Le Cormier : Silo, Silo 2, Silo 3 et Silo 4 ainsi que « L’interminable évidence de se taire » témoignent à souhait de ton observation. Je me suis assez rapidement vu noyé par l’arrivée des mots. J’étais submergé. Les diverses formes brèves dont tu as dressé l’inventaire et auquel j’ajouterais, pour ces livres surtout, la figure de la tautologie, étaient comme des respirations hors de la noyade. La seconde d’arrêt que nous figurons. La minute qui éclate, celle que nous formons, le temps de nos vies, dans l’immense flux du vivant où nous ne sommes qu’un mince filet de pas. Cette dernière image rejoignant la figure de l’isthme que tu as relevée plus haut et que tu as choisi d’illustrer par une citation.
Mathieu, j’aimerais réfléchir encore à ce « quelque chose de plus grand » que tu as avancé dans ta question. Les formes brèves, fragments, éclats, aphorismes, apophtegmes, tout isolats, seraient-ils par excellence l’ultime métaphore de notre condition humaine ? Ces figures de style ne renverraient-elles pas, dans les mots, à l’enfermement de notre conscience quant au monde, à notre présence, etc. ? Ces isolats seraient-ils l’image de notre tautologie essentielle ? Sans craindre de me répéter, nous sommes des producteurs de sens. Notre silence même fait sens. Pourtant, à la question de Leibniz, « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » formulée en 1697 dans De l’origine radicale des choses, nous n’avons pu apporter que des significations, inévitablement fondées en nous.
Nous sommes dans une solitude ontologique et les mots nous y rapportent sans cesse, eux dont nous usons pourtant pour nous exprimer ! (22.04.2024)