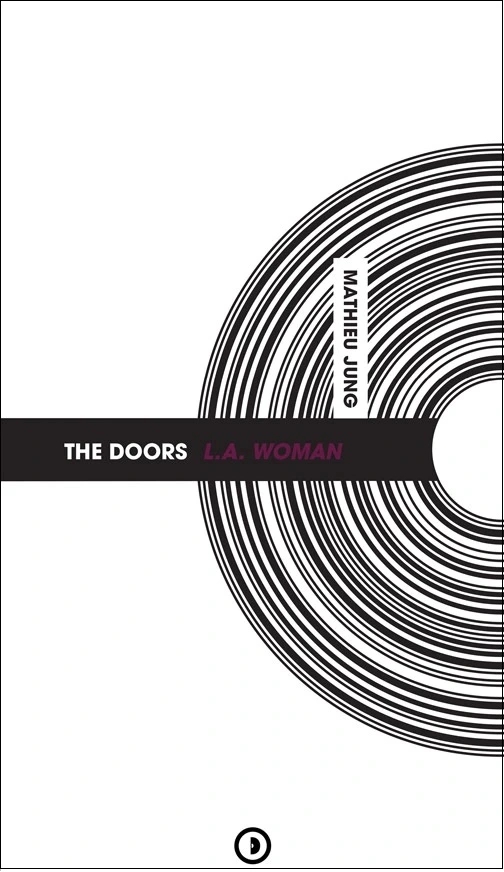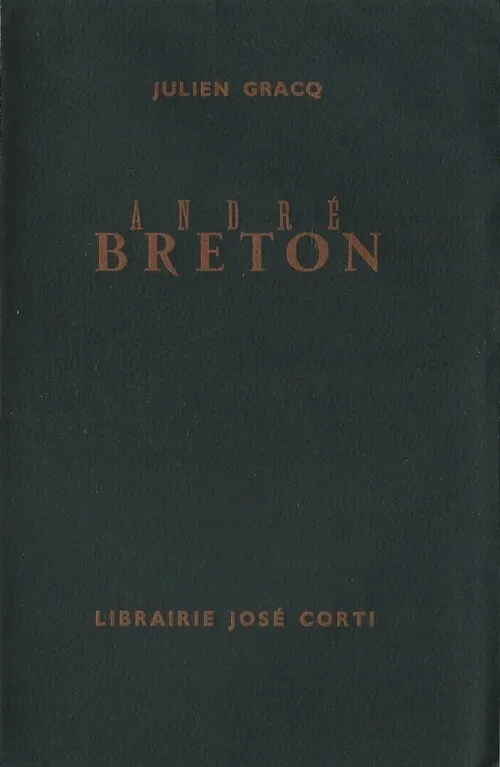en écoutant le maloya de Zanmari Baré
dans l’attente éperdue de Messer Sogol
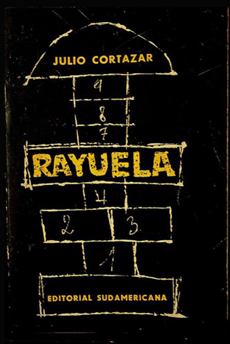
Soit un auteur argentin qui, à l’instar de ses aînés Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares, s’aventure par les sentiers féconds du réalisme magique (il peut en effet arriver dans ses récits que l’on vomisse des petits lapins (« Lettre à une amie en voyage », Bestiaire (1951)), et l’on trouvera une étrangeté et un art du fantasque non moins exacerbés dans Cronopes et fameux (1962)), mais l’œuvre polymorphe de Julio Cortázar culmine avec Marelle (1963), roman-culte qui ouvre sur une citation de Jacques Vaché (« Rien ne vous tue un homme comme d’être obligé de représenter un pays. »), les citations sont il est vrai nombreuses dans cette encyclopédie réticulaire, dans ce grand résumé du monde où l’on apprend, entre mille autres choses, comment servir idéalement le maté (et peut-être est-ce là le véritable sujet de Marelle), où il est question de la parallélépipédité des morceaux de sucre, où le jazz le dispute à la littérature, où l’on nous rappelle — on en avait l’intuition depuis Nerval au moins — que Paris est une vaste métaphore et l’on assiste quelquefois à une sorte de dérive psycho-géographique dans cette ville (Cortázar est éminemment moins déprimant que Guy Debord et ses copains), roman double et infini, véritable matrice d’écriture ou de désécriture, mais de réécriture aussi bien, inépuisable roman-monde où il fait bon s’égarer qui, de même que La Vie mode d’emploi (1978) de Georges Perec, ouvre sur le mot « Oui » — tout se passe comme si ces auteurs, Cortázar, Perec, chacun selon ses moyens — ils sont considérables — reprenaient la forme romanesque là où James Joyce l’avait laissée avec le « Oui » de Molly Bloom.
« Oui, mais qui nous guérira du feu caché, du feu sans couleur qui, à la nuit tombante, court dans la rue de la Huchette, sort des portails vermoulus, des étroits couloirs, du feu impalpable qui lèche les pierres et guette sur le pas des portes, comment ferons-nous pour nous laver de sa brûlure douce qui se prolonge, qui s’installe pour durer, alliée du temps et du souvenir, des substances poisseuses qui nous retiennent de ce côté-ci, et qui lentement nous consumera jusqu’à nous calciner ? » (Marelle [Rayuela], ouverture du chapitre 73, ou chapitre premier).
Comment ne pas voir en les livres de Cortázar, l’extrait ci-dessus est en cela exemplaire, un prolongement des grandes proses surréalistes comme L’Amour fou (1937) qui, y compris d’un point de vue non strictement formel, ne sont elles non plus pas dénuées de vigueur et, pour tout dire, de fraîcheur (la lettre à Écusette de Noireuil reste, sur ce point, insurpassable) ? Mais, contrairement à André Breton, Cortázar laisse filer sa syntaxe — pour tout dire, sa fiction — selon des lignes jazzées, savamment relâchées.
— Les tiennes, de phrases, sont vache chiadées et un peu longues. Tu te prends pour qui ?
— Pardon ?
— Je n’arrive pas à les lire sur l’écran de mon smartphone. Même l’histoire des petits lapins, les gens ont décroché. Ils ne sont même pas allés au bout de la première phrase de ton article, tu sais.
— Ah.
La vibrante solennité de Breton (son côté péremptoire, diraient de bien mauvaises langues) n’entre pas dans le répertoire joueur et enjoué de Cortázar : « … un monde où tu avançais comme un cavalier d’échecs qui eût avancé comme une tour qui eût avancé comme un fou. » (Marelle, 1). Il faut lire les pages de Marelle consacrées à la Sibylle pour se convaincre de la chaleur et de la sensualité de Cortázar. Il arrive que cela se manifeste à la faveur de l’invention d’une langue affective, aux phonèmes joliment érotisés, le gliglicien. Voici :
« À peine lui malait-il les vinges que sa clamyce se pelotonnait et qu’ils tombaient tous les deux en des hydromuries, en de sauvages langaisons, en des sustales exaspérants. Mais chaque fois qu’il essayait de buser les sadinales, il s’emmêlait dans un geindroir ramurant et, face au nu ovale, force lui était de se périger en se réduplinant et il restait éfloué, tout comme le triolysat d’ergomanine dans lequel on laisse tomber quelques filules de bouderoque. » (Marelle, 68).
Mais il me plaît surtout à penser à Cortázar comme à un homme des passages, à la manière rêveuse et inquiète de Walter Benjamin. Or, le passage de « ce côté-ci » à l’autre ne va pas sans une torsion imprimée à la fiction, sans un chiasme entre la vie et le Grand Rêve, dont des titres comme Le Tour du jour en quatre-vingts mondes (1980) ou Les Autonautes de la cosmoroute (1983) témoignent astucieusement.
D’astuce justement, Marelle en déborde. Il est un chapitre, on relira ou découvrira lequel, où deux textes alternent ligne à ligne. Il faut donc lire une ligne sur deux, puis reprendre. Derechef une ligne sur deux, mais en recommençant à la deuxième ligne. Cette manière de faire clignoter la duplicité du fictif est aussi une réduplication de l’ensemble du roman, où deux parties de trois-cent pages chacune sont imbriquées. Car on est amené à circuler dans le volume de Marelle qui est une opera aperta par excellence. Au point que l’on nous explique que le livre se termine au chapitre 56. Si l’on prend le parti de lire de manière linéaire jusqu’à la fin du chapitre cinquante-sixième donc, les quatre-vingt-dix-neuf chapitres suivants sont inutiles. On est nel mezzo del cammin du bouquin et la lecture est finie. Non. On est plutôt invité à sauter d’un chapitre à un autre, un peu à la manière de ces « livres dont vous êtes le héros » dont, enfant, j’étais friand (Philippe de Jonkheere a dit un jour que Cortázar est l’inventeur du lien hypertexte). Il est un « mode d’emploi » au début de Marelle, qui indique l’ordre des chapitres : « en cas d’incertitude il suffira de consulter la liste ». À la fin de chaque chapitre, un numéro indique la prochaine destination. Je me suis toujours demandé si l’ordre donné dans le mode d’emploi est bien le même que celui induit par la numérotation en fin de chapitre. Je n’ai pas pris la peine de vérifier, préférant me figurer une sorte de Marelle fantôme, qui sans doute existe, mais peut-être n’existe pas.
La lecture est l’autre nom de l’écriture. « Puisque la lecture abolit le temps du lecteur pour transférer celui-ci dans le temps de l’auteur. » (Marelle, 79). L’enfant que l’on disait sensible, mais c’était déjà là une grande bouderie contre le monde tel qu’il est, et il irait, le monde, de mal en pis (de l’écriture considérée comme art de la bouderie, travail du négatif s’il en est), et bien qu’il eût sans doute d’excellentes raisons de faire la gueule, l’enfant commençait néanmoins d’apprendre qu’il est des portes dérobées au sein de la fiction, lesquelles ouvrent sur le Grand Rêve, portes d’ivoire ou de corne, etc.

Tout ou partie de l’œuvre de Cortázar est affaire de passages. Dans Marelle, ce sont tantôt des glissements subreptices tantôt des basculements soudains d’un monde à l’autre, de Paris à Buenos Aires par exemple (voir aussi le récit « L’autre ciel » (Tous les feux le feu, 1966)). Ces grands bonds hallucinés selon la marelle d’un récit « désécrit » — notion cruciale — sont aussi des entreprises belles et chancelantes, comme lorsque Traveler et Oliveira tentent de relier par deux planches les fenêtres de leurs appartements respectifs (chapitre 41), de sorte à pouvoir faire passer des sachets de maté d’un endroit à l’autre.
Un mot sur la désécriture dont se revendique Cortázar à travers le personnage de Morelli, et sur ses enjeux politiques. Les valeurs conservatrices, quand il s’agit d’écriture, ont quelque chose de suspect. « À quoi sert un écrivain si ce n’est à détruire la littérature ? » (Marelle, 461). Ce n’est pas un hasard si Morelli cite « Haine de la poésie » de Georges Bataille. Mise en crise de la poésie (l’inverse exact des tenants de la droite réactionnaire française actuelle), la haine de la poésie est viscéralement politique. « Il faudrait qu’au terme d’une négociation, d’un compromis social et romanesque, le partage soit égal : 50 % de politique, 50 % de littérature. Si trop de politique, le littéraire s’avachit ; si trop de littérature, le politique se dissipe. » constate Nathalie Quintane, non sans ironie, dans l’ouvrage collectif Contre la littérature politique (2024) où le « contre » vise à mieux se réapproprier le terme de « politique ».

Du poème pompiériste qui fasse poésie, du roman anodin, bête. Voilà précisément ce en quoi consiste cette littérature fade à l’usage des bourgeois qui se vend actuellement en France — récit de voyage ou poésie péroxydée. À l’usage des bourgeois mais pas seulement. Les ravis de la crèche sont aujourd’hui de tous bords.
Le poison, c’est la fadeur. La fadeur, dans le roman, dans le poème, c’est la bêtise.
— Il faut toujours que tu parles de politique.
— Mais on ne nous laisse plus d’autre alternative.
— Non, ce qu’on veut nous c’est de la littérature. Pas de la politique. Et pas des phrases aussi longues.
— Ah.
— Et puis, hein, on est toujours le bourgeois de quelqu’un non ?
— C’est bien une remarque de bourgeois, ça.
Cette fadeur est conforme à l’esthétisation de la politique dans les régimes dont la démocratie est défaillante. Processus là encore fort bête, pompiériste. W. Benjamin, lui encore, nous avait bien prévenu contre cette tendance. Face à cela, je n’ose pas écrire en solution à cela, le travail du négatif, du contre, de la « haine de la poésie » servent à revitaliser la poésie, le roman aussi, tant qu’à faire, en leur donnant un coup de fouet politique.
Fin de l’excursus politique. On peut reprendre ici l’habituel ronron de la lecture distraite.
Le passage de « ce monde-ci » à l’autre s’autorise de ce que « la distinction entre le fond et la forme est une chose fausse » (Marelle, 99). Mieux : récuser cette opposition classique fait de la poétique du passage une composante essentielle de la fiction. Ainsi, Marelle, mais il en va de même pour nombre de récits chez Cortázar, est un roman composé (désécrit) à l’échelle un. Le passage permet d’établir un récit qui fonctionne sans solution de continuité entre le livre et le vivre (voir la nouvelle métaleptique par excellence « Continuité des parcs » (Fin d’un jeu, 1956).
Dans cette perspective, Marelle résulte également d’une manière assez éhontée d’inclure les notes de régie au sein d’un roman déjà très conscient de lui-même (un peu comme si on avait mêlé dans un joyeux shaker Les Faux-monnayeurs à leur Journal — Cortázar ayant, au reste, traduit Gide en espagnol). Cela témoigne d’un rapport jubilatoire à l’espace littéraire (« Tu es dostoïevskiennement dégoûtant et sympathique à la fois, une espèce de lèche-cul métaphysique. » (Marelle, 29)) ainsi que d’une manière de liquidation de tout. Idéalement, il faudrait récuser les cadres, la représentation : « … il faudrait ouvrir toutes grandes les fenêtres et tout jeter dehors, mais il faut surtout jeter aussi la fenêtre, et nous avec. » (Marelle, 147).
Morelli se charge de défaire le roman, en s’opposant à la conception du roman « en rouleau-chinois ». Mais le discours de ce personnage un peu présomptueux est gage d’une déconstruction plus fine et plus ironique encore de la trame romanesque.
On le sait, tout art poétique est affaire de disparition. Et le roman, pour peu qu’il soit mené sérieusement (avec pertes et fracas) ne fait pas exception à la règle. Mais la poétique romanesque de Julio Cortázar est aussi un art consommé de la réapparition. De la réapparition en un autre lieu, sous une autre forme. L’enjeu consistant à effectuer la traversée de l’Impossible.
« Un tout petit Cronope cherchait la clef de la porte d’entrée sur la table de nuit, la table de nuit dans la chambre à coucher, la chambre à coucher dans la maison, la maison dans la rue. Là, le Cronope s’arrêta car, pour sortir, il lui fallait la clef de la porte. » (« Histoire », Cronopes et fameux)