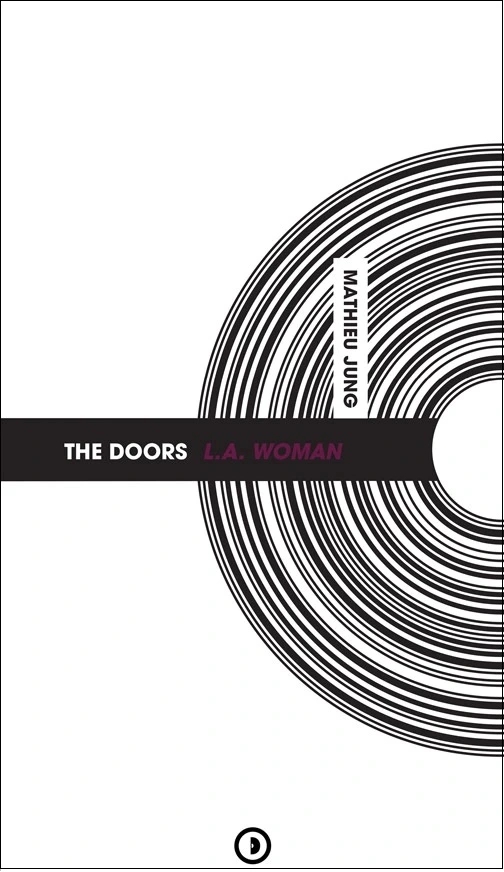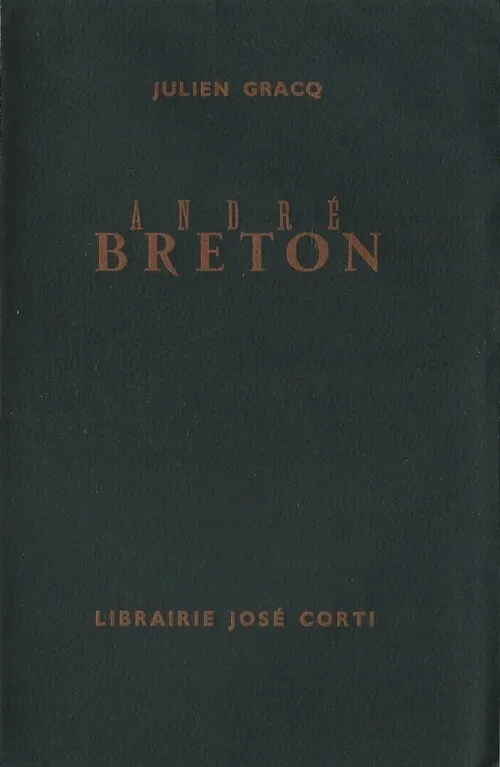What thou lovest well remains,
the rest is dross
(Canto LXXXI)
On lit Ezra Pound en se bouchant le nez. Sans comprendre, souvent, pourquoi on se bouche le nez. Puisque Pound est incompréhensible. On lit Pound, sans savoir pourquoi on le lit. Puisqu’il est incompréhensible. Seulement, on nous a dit qu’il fait partie du canon. Il compte parmi les plus grands noms du modernisme, non loin de Yeats, Eliot ou Joyce. C’est sans doute vrai, mais là n’est pas la question.
En France, où l’on ne saisit pas bien la notion de modernisme littéraire (et peu importe), Denis Roche, Michel Butor, Jonathan Pollock ou encore Claude Minière se sont beaucoup intéressés à lui. Deux Cahiers de l’Herne sont consacrés à Pound. Cela devrait suffire pour qu’on y aille voir. À nouveaux frais, si possible, loin de l’aura aussi prestigieuse que scandaleuse de ce poète. Ce d’autant que l’on dispose d’une édition en langue française des Cantos, parue chez Flammarion.
Mais cela continue d’intimider. C’est fait pour. Il ne suffit pas de traduire Pound. Une part non négligeable des Cantos reste, qu’on le veuille ou non, du chinois…

Blague à part, dans le magma de l’œuvre incoercible, il y aurait peut-être néanmoins une voie d’entrée praticable. Celle de l’amour. Et cela paraît presque grossier lorsque l’on pense aux excès de Pound, à sa folie politique. Il y a, il est vrai, un versant effroyable de l’œuvre de Pound.
Or, aimer Pound. De Soral à CasaPound, on aime Pound, mais pour d’autres raisons, bêtement politiques, qui permettent que l’on fasse l’économie de la lecture des Cantos.
Or, aimer Pound. Et il ne s’agit pas de la solution éminemment paresseuse qui consiste à vouloir séparer l’œuvre du salaud.
Qu’un livre exigeant comme les Cantos fasse l’épreuve du mal relève d’une forme de nécessité, et cela ne la justifie en rien, ni n’en exonère son auteur : la réciproque ne fonctionne pas (il ne suffit pas de tremper l’œuvre dans le mal pour qu’elle gagne en force ou en vérité).
Je songe à Allen Ginsberg rendant visite à Pound à Venise, en 1967. Il fit écouter au vieux Pound (il allait vers sa quatre-vingt-deuxième année) des morceaux des Beatles, de Bob Dylan et de Donovan, fumant de l’herbe et lui récitant quelques mantras. Pound à Ginsberg : « Mais ma pire erreur, ce qui a tout gâché depuis le début, a été mon stupide préjugé banlieusard d’antisémitisme » [lire et voir ici].
Après son séjour à St. Elizabeths, l’établissement psychiatrique où Pound avait trouvé précisément asile de 1945 à 1958, arrivé à Naples, Pound fit le salut fasciste, déclarant que c’est toute l’Amérique qui est un asile d’aliénés. Tout cela est su, fait partie de la vulgate. Ces histoires, à force d’être ressassées, ont fini par perdre toute forme de signification. Elles ont été lessivées, sans que Pound en sorte blanchi : on tend à liquider l’œuvre de Pound, on ne cherche pas à y aller voir, au prétexte non infondé de ses idées politiques.
Il faudrait être en mesure de maintenir le paradoxe tel quel, avoir le courage ou la naïveté d’un Ginsberg pour s’aventurer dans l’impensable. C’est à ce prix-là que l’on peut être en mesure d’aimer Pound.
Il y a un effort aussi exorbitant, pas dans mes cordes en tout cas, et c’est celui d’Auxeméry traduisant et commentant The Classic Anthology Definined by Confucius (1954) de Pound, près de 500 pages parues chez Pierre Guillaume de Roux en 2019 — bien sûr que les belle âmes grimacent au nom de l’éditeur. Traduire Pound, a fortiori Pound traduisant Confucius, n’est pas sans démontrer, et de manière magistrale, à quel point la traduction fait partie de plein droit de l’espace littéraire — et il arrive qu’elle aménage et creuse l’écart — quand bien même cet art ne dispose pas de muse (cf. W. Benjamin), ou que ce geste consiste à jouir de la muse d’un autre, pour paraphraser Pierre Vinclair, lui-même traducteur du Shi Jing (Le Corridor Bleu, 2019).
Les mots qui concluent les Cantos sont pour Olga Rudge, qui fut la seconde compagne d’Ezra Pound :

Cette incroyable gageure qui consiste à vouloir aimer Pound se justifie à mes yeux pleinement dans ces quelques vers jetés là, pour Olga. Qu’ils figurent idéalement à la fin des Cantos, œuvre interminable à bien des égards, n’est pas sans nous encourager à lire ce poème à rebours, en commençant par la fin, par cette adresse qui en est le dernier mot (et est prévue comme telle). Anne Conover a établi la biographie d’Olga Rudge (Olga Rudge & Ezra Pound, Yale University Press, 2019), et cet ouvrage est un autre point d’accès à Pound.

D’autres poèmes ont été composés pour Olga entre 1962 et 1972, en voici un extrait :

Il y aurait une étude à mener sur Ezra Pound et l’amour, sur Ezra Pound amoureux. Les biographes en parlent, bien entendu, dont Conover. L’amour apparaît dans le bruit et la fureur des Cantos, au milieu des invectives politiques, des délires économistes, des visions idéogrammatiques, d’une langue italienne idéalement rêvée et des mille choses savantes qui font de ce grand poème quelque chose d’incompréhensible mais que je m’obstine à trouver beau. Un lecteur de Dante et des troubadours aussi passionné que Pound n’a pas pu laisser de côté l’amor che move il sole e l’altre stelle.
Tâcher d’aimer Pound n’est peut-être rien comprendre à l’incompréhensible Pound, mais c’est déjà cela.