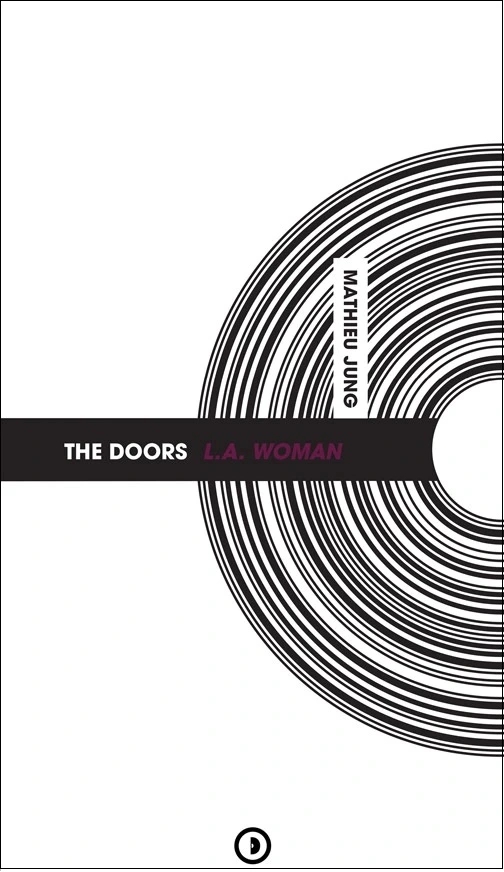pour Patrick Werly
Les livres de L’Atelier contemporain se présentent généralement comme des livres d’images, dont l’iconographie, riche et bien présente, participe de l’économie, de la logique même de ces élégantes publications. Ouvrages fabriqués par un éditeur-héros, bouquins faits pour le regard, où pictura et poesis se nourrissent l’une de l’autre. Mais il arrive que l’image, la pictura, soit laissée de côté. Sans pour autant que le livre devienne autre chose qu’une injonction séduisante au regard, à la pensée. Partant, au désir.

Les Salons de Giorgio Manganelli (2018, première édition italienne : 2000, chez Adelphi) rassemblent trente-cinq comptes rendus d’exposition qui, chacun, en appellent au regard du lecteur, mais ce sont, ici où l’on ne nous dit rien, des proses avec figures absentes, dont on ne discerne pas immédiatement — ni peut-être jamais — les contours ou les ombres portées. Cette absence exige une acuité autre. En cela que la clarté de Manganelli travaille avec de l’indiscernable. Eau, vent, éléments — formes fragiles, combien proches du naufrage.
Comme issu d’un lumineux sauvetage, le premier de ces textes, « La mâture de l’aube » — trois pages de cristal maitrisé —, ne semble pointer sur aucun objet défini. En tout cas, on ne nous en garantit pas l’accès. On répugne donc, en retour, à en faire la description ; ce serait une descrizione della descrizione, une de plus, sans que l’on sache de quoi il retourne exactement.
Laissons parler l’image d’elle-même, sans sa figura, telle que Manganelli la laisse infuser et diffuser tout à la fois. « Un char des dieux, la juxtaposition de visages instables et autres semblables, un atermoiement champêtre, une frénésie de gondoles, et la délicatesse d’un bâtiment dessiné et décomposé, tout fait allusion à une sublime turbulence inachevée, un frisson de formes innombrables qui sont tout à la fois des ombres et des reflets. » On doit la traduction de ces Salons à Philippe Di Meo, qui saisit l’italien allusif de Manganelli et le porte au plus près de nous. À mieux dire, le ramène à nous, ici-bas, en France, à hauteur de cette précaire rationalité qui, pour tout dire, nous empêche de comprendre combien l’auteur de Hilariotragoedia (1964) est joueur et profond. Et riche et varié. Ce d’autant que Manganelli, écrivain au génie exigeant, place l’évidence (absente) sous les yeux de qui le lit. « La fièvre inépuisable du ciel heureux s’en remet à la brève, labile conclusion d’une carte, gouvernée par une main innombrable. »
Manganelli nous donne à voir (à rêver) un Isolario vénitien de 1534. La méditation à partir de portulans ou de cartes maritimes est sans doute infinie : Giacomo de Maggiolo, Piri Re’ is, Diogo Ribeiro — autant d’artisans de l’impossible. « Et comment ne pas se souvenir que derrière cette extraordinaire entreprise cartographique et picturale, s’étend l’espace du voyage d’Odysseus, autre habitant de l’Isolario ? » Le plus beau, c’est que cet ouvrage de Benedetto Bordone (illustrateur par ailleurs du plus beau livre, a-t-on pu dire, de tous les temps, Le Songe de Polyphile), aurait pu, tout aussi bien, ne pas exister. C’est désormais indifférent, puisque Manganelli en a parlé. Bien sûr que la poésie vient avant le monde. Que m’importe, au fond, si Dublin ou Strasbourg existent bel et bien, puisque Joyce et Jean-Paul Klée en ont parlé ?
Très vite, parcourant les Salons de Manganelli, on prendra le parti de la rêverie. J’aperçois pour ma part le Consul Firmin, pour son dernier jour, dans les pages consacrées à l’éphémère Empereur Maximilien (1832-1867). « Maximilien partit pour le Mexique comme dans sa jeunesse il était parti pour Smyrne, ce lieu cher aux historiens de la Vénétie et de Vienne. Peut-être que Maximilien se demanda si le monde était un théâtre ou un bonheur-du-jour des stupeurs, ou s’il était l’une et l’autre chose : mais certes, il ne douta pas que sa vie dans ce monde fût stupeur. Voici qu’il s’embarque dans une exultation de rames, mais c’est également un adieu ; il quittera Miramar pour toujours ; mais en échange, en un troc sinistre, le destin lui offre le Mexique tout entier et une couronne d’empereur. Impossible. Divertissant. Somptueux. Fastueux. »
Ce livre d’images propose une surprenante méditation à partir de la peinture de Paul Delvaux. Il est alors question d’ « Illustrations pour livres inexistants », pour aboutir à cette abyssale question : « Donc : est-ce de la peinture ? Est-ce une littérature de l’inexistant ? Le néant illustré ? » Belle et presque ineffable, l’interrogation se répercute au fil de ces Salons aux figures absentes.