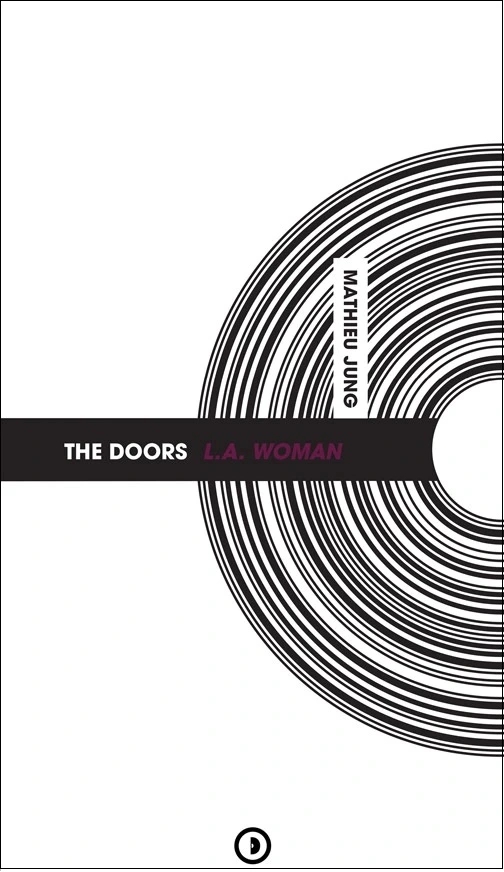Première expérience, tout à l’heure, d’un TD mené en visioconférence avec une vaillante poignée d’étudiants de Master en Arts du spectacle et de la scène. Spécialistes de cinéma, art auquel je n’entends couic. Et spécialistes inspirants et inspirés, il faut que cela se sache. Au programme, Mythologies de Barthes, en particulier « Le monde où l’on catche » — avec les pages consacrées à la D.S. ou au cerveau d’Einstein, passage le plus connu du fameux ouvrage. L’idée consistait à la jouer prudemment, avec un texte célèbre, qui devrait leur parler tout naturellement. Ce fut le cas. En amont, ils avaient eu droit à Barthes en vidéo, un documentaire un peu daté qui se trouve désormais sur le site de l’INA, et aussi sur Youtube. Agrémenté d’un programme de France Culture qui parle des Mythologies, avec Typhaine Samoyault et Eric Marty. Causerie menée par — sa voix mauvaisement cajoleuse — Raphaël Enthoven qui se gausse, et cela ne surprendra personne, de l’ « usager de la grève » dont parle Barthes.
Absolument aucune maîtrise de l’outil visio (je passe sur les tracas liés aux inénarrables identifiants, cela m’a pris une partie de la matinée), ce d’autant que le rapport de conversation est asymétrique : eux me voyant vaticiner depuis mon salon, moi ne les voyant pas. Pire encore : moi me voyant leur parler en ne les voyant pas eux, les cherchant du regard.
Misérable miracle de l’écran. Expérience presque psychotique, vers laquelle, au reste, tend notre monde, notre quotidien. Mon besoin de retour, de feedback (ie. nourrir-en-retour), est impossible à rassasier. C’est en somme la communication qui fout le camp. Des voix auxquelles s’accrocher, cependant, les leurs. Et un peu d’écrit, sous forme de t’chat (sic), dans une fenêtre sur la gauche. Sinon, que dalle. On prêche dans le désert numérique.
Puissante expérience de dépersonnalisation. Pas besoin de rouvrir Levinas pour comprendre que le visage est essentiel, lors d’échanges, de discussions.
Je sais exactement par où aborder Barthes. Mais très vite, n’ayant pas leur regard en retour, je bafouille, je raconte à peu près n’importe quoi. Je fais le mariole devant mon écran. Je suis en somme moins doué qu’Enthoven. C’est dire. Mais ce que je comprends, assez rapidement, c’est qu’il convient que je m’appuie sur leur parole à eux. Je les écoute. Je les supplie même de parler. Parce qu’on va tâcher de tenir deux heures. Mais oui. On parle du catch en tant que spectacle (dans mon dos, l’œuvre de Guy Debord me toise, dans la bibliothèque), et l’un des étudiants parle soudain de boxe, par association d’idées, sport et ring, combat. Cela fait tilt. Sous le contrôle de Debord, donc, qui doit un peu se moquer de moi qui suis ainsi à me perdre face à mon écran. Mais la distinction est féconde entre boxe et catch.
Je lance un exemple un peu rigolo, le match de charité (« ça peut faire mal quelquefois la charité »), dans Rocky III, où Sylvester Stallone se bat pour de rire contre Hulk Hogan. (Au passage, nous méditons sur le fait qu’au cinéma, dans la critique cinématographique on parle volontiers de l’acteur, on emploie souvent le nom de l’acteur, sans forcément parler du personnage. Souci ontologique majeur, bien sûr, mais cela me passionne ce nœud qu’il peut y avoir entre l’acteur et son personnage, a fortiori dans un cas comme celui de Stallone. Le moi cinématographique actoriel n’est pas le moi romanesque, cette évidence me saute au visage et je ne pense plus qu’à ça à mesure que continue la visiocauserie, et que moi-même je ne suis pas bien sûr d’être vraiment moi-même devant le miroir-mouroir de l’écran.)
L’avantage, réel, qu’il y a à faire cours depuis son salon, c’est la proximité de la cuisine, où se trouve une machine à café. Je continue d’écouter les étudiants, m’étant absenté faire mon café. C’est à ce moment que je suis en vie, quittant l’écran.
L’étudiant qui parle alors d’Henry Fonda jouant exceptionnellement le rôle d’un salaud, est soudain pris de panique : lui aussi fait l’expérience de la psychose, de la parole sans feedback (pire : au loin le bruit de ma machine à café), et il m’entend tâcher de le rassurer : « Continuez, le café est en train de couler ». Car on en est là : cernés par la psychose, chacun dans sa solitude, dans un état spectral constant.
Heureusement, il y a le café. On ne nous a pas encore enlevé ça.
Parole vaine. La mienne surtout, devant ma machine à café Nespresso. Mais ce qui importe à ce moment, c’est que ça cogite, d’autres étudiants écrivent dans le t’chat, affinent ce qui se dit oralement. Bref, ça phosphore et je reviens mourir devant l’écran, nanti de ma tasse de café.
Cette histoire de moi actoriel me travaille et eux aussi il me semble (en tout cas je ne pense qu’à cela), tandis que la causerie évoque le théâtre, le spectacle, l’image et l’idée un peu curieuse d’un signe sans signification, qui est sans doute une vieille scie aristotélicienne — la forme des formes. Je lance l’entéléchie donc, pour voir où ce qu’elle retombe. Et j’ai l’impression que ça parle à l’un ou l’autre des spectres à qui je m’adresse. La formule d’Hölderlin me revient aussi (« signe sans sens », dans son ébauche de Mnémosyne). Je ne suis pas long à les initier un peu aux épiphanies de Joyce (« revelation of whatness », quiddité tout ça), et je leur demande, fort candidement — c’est une vraie question — si une pareille chose qu’une épiphanie au cinéma est possible. Vraiment ? Mais vous êtes sûrs ?
A Woman under the Influence, de Cassavetes. Il y a sans aucun doute de l’épiphanie là-dedans. Gena Rowlands, dans Opening Night, jouant le rôle d’une comédienne. C’est à ce moment à peu près qu’est arrivée la notion de métalepse (car Gena crève l’écran), mais elle traînait déjà dans la discussion alors qu’on évoquait la boxe et le catch, et je pense que son irruption a même été indissociable de boxe et catch.

Un des étudiants a formulé une idée que je trouve fort stimulante : la métalepse est davantage une affaire littéraire ou théâtrale. Au cinéma, la métalepse arrive, semble-t-il, plus difficilement. Le cadre de la fiction n’est pas le même. Une distinction majeure est sans doute esquissée ici, rapidement, en visioconférence. Trop rapidement. Il faudra creuser cela. Ces moments où l’on opère une fissure, une fêlure dans la représentation. Lorsque Belmondo, dans Pierrot le fou, parle « aux spectateurs », ce n’est pas vraiment une métalepse. Ce moment d’anthologie est toujours déjà pris et maintenu dans le cadre, même godardiennement foutraque, de la représentation. Alors oui, il y a cette auto qui passe en arrière-plan dans le Falstaff d’Orson Welles (je ne me souviens plus où hélas, il faut me croire sur parole), et c’est vraiment, à mes yeux, une irruption du réel, cette bagnole dans le fond d’une scène qui se passe au Moyen-âge, une sorte de trouée dans la représentation. Ce n’est pas voulu, bien sûr. Mais la métalepse est, semble-t-il, plus rare ou plus difficile (moins naturelle ?) au cinéma que dans le roman. C’est une de nos grandes hypothèses de la journée. Il en faut des comme ça, des journées et des hypothèses. En parlant de métalepse, je me demande ce qu’un cinéaste pourrait faire d’aussi radical que René Crevel dans Les Pieds dans le plat (qui est un roman), lorsqu’il écrit : « Celui qui a jeté treize personnages sur une colline ne dispose plus d’eux. Il n’est pas maître des réactions à quoi le contraindront ces noyés ramenés des marais de la mémoire, des trous de cauchemars. » Ce sera peut-être pour la prochaine session de communication visiospirite avec des étudiants.