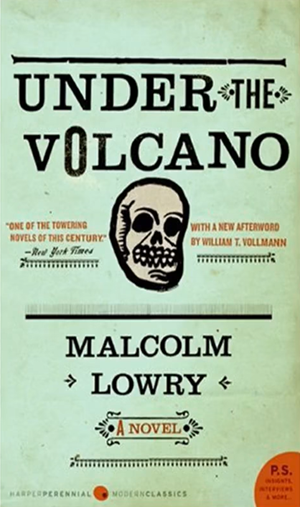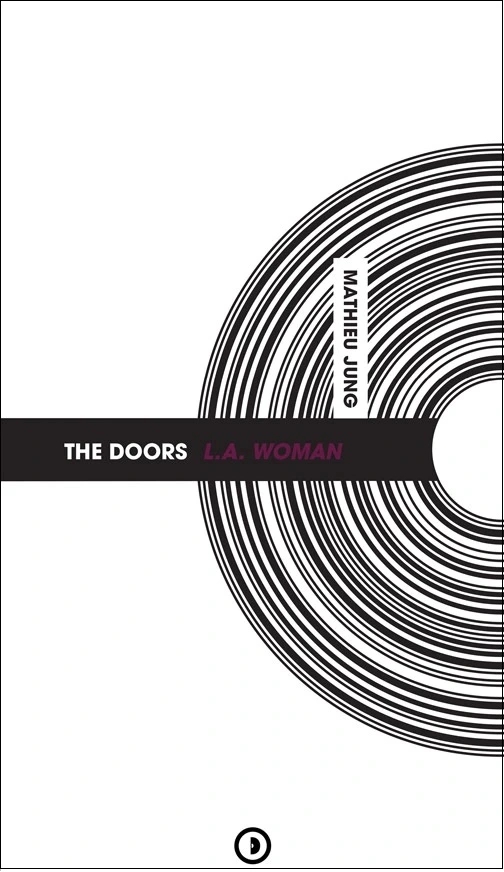Even he, Joyce,
had love
Even blind poets
(Jack Kerouac)
Lucia Joyce: to Dance in the Wake. Pour tout ce qu’il a d’intraduisible et de beau, le titre du livre de Carol Loeb Shloss mérite que l’on s’y arrête. Littéralement, la vie de Lucia Joyce, dans le sillage (wake) de son père illustre, James Joyce.
Une des passions de Lucia fut la danse. Carol Loeb Shloss en prend merveilleusement acte et nous invite à danser dans le sillage de Joyce, des mots de Joyce. Une folle traversée du Wake, les yeux ouverts. En cela que wake, en anglais, signifie aussi la veille. Mais pour tâcher de déchiffrer ces lucides entrechats, ces aberrantes pirouettes, il convient de garder à l’esprit que la veille de Joyce, périple au bout de la nuit s’il en est, ne saurait avoir lieu que de l’autre côté de la vie. Lucia, dans une lettre datée d’octobre 1934, nous le rappelle : « Qui sait ce que nous réserve le destin ? En tout cas, bien que la vie semble pleine de lumière ce soir ici, si jamais je m’en vais, ce sera pour un pays qui par un côté t’appartiendra, n’est-il pas vrai, Père ? »

Finnegans Wake, impossible grimoire, livre en attente — sans doute pour longtemps encore — d’un lecteur idéal souffrant d’une idéale insomnie. Le Wake, c’est aussi, à la mode irlandaise, une joyeuse veillée funèbre où la joie se mêle à la peine, où les extrêmes sont appelés à se rencontrer. Le génie y flirte comme souvent avec la folie, et la cécité ne manque pas d’y être relayée par le don de seconde vue en une manière de « point sublime ». Si bien que, dans le sillage de Joyce et presque comme en rêve, Carol Loeb Shloss livre un récit touchant et déchirant, une des plus belles histoires d’amour du vingtième siècle. Amour fou, oui, que celui de Joyce pour sa fille. Lisant cette vie de Lucia, on pensera peut-être à une lettre fameuse d’un père à sa fille, celle d’André Breton à Aube, sa chère Ecusette de Noireuil. Il y est, autant que dans l’œuvre ultime de Joyce, beaucoup question de vue, de vision, de regard, de rêve et de danse : « Tous les rêves, tous les espoirs, toutes les illusions danseront, j’espère, nuit et jour à la lueur de vos boucles et je ne serai sans doute plus là, moi qui ne désirerais y être que pour vous voir. … Sous de légers voiles vert d’eau, d’un pas de somnambule une jeune fille glissera sous de hautes voûtes, où clignera seule une lampe votive. »
Une photographie — elle figure en couverture du livre — montre Lucia en fille du pêcheur, dans son costume de poisson d’or confectionné par elle à l’occasion d’une représentation au bal Bullier. C’est la fille de son père, et elle danse. Jeune fille au pas de somnambule. La photographie date de mai 1929. Années folles. Temps de misère et de détresse, tellement comparables aux nôtres. L’Histoire se répète, Dieu radote. Alors qu’il s’est aliéné le soutien de ses plus fervents admirateurs (Ernest Hemingway, Ezra Pound et altra), l’aveugle Joyce poursuit son inlassable veille à mesure que l’ondine Lucia s’enfonce dans ce qu’on s’est résolu, un peu hâtivement selon Carol Loeb Shloss, à qualifier de schizophrénie. Le vieux fou que plus personne ou presque ne veut comprendre va se persuader que sa fille guérira une fois son livre terminé. Joyce, avatar moderne du vieux Lear, fou d’amour pour sa fille, jusqu’à l’aveuglement : « si ardemment que je désire sa guérison, je me demande ce qui arrivera si quelque jour elle détourne son regard de cette rêverie illuminée de voyance vers ce visage raviné de vieux cocher qu’est le monde. » Ou encore : « Quelle que soit mon étincelle de talent ou de génie, elle a été transmise à Lucia et a mis le feu à son esprit. »
1935. Les troubles de Lucia sont des plus inquiétants. Son père, absorbé par l’écriture du Wake, a perdu le sommeil, abuse des barbituriques et se voit poisson bondissant hors de l’eau. On se souvient de la formule de Carl Gustav Jung, au sujet de Joyce et de sa fille : deux personnes dans une rivière, l’une y plonge et l’autre y sombre irrémédiablement. Folie d’écriture (psychose latente, selon Jung), mais aussi, et surtout, « absence d’œuvre » pour la fille que l’on a, à la suite du biographe incontesté de Joyce, Richard Ellmann, trop souvent considérée comme une « réplique inhibée et torturée » du génie de son père.
Carol Loeb Shloss propose précisément de rendre justice à la fille de Joyce en questionnant cette absence d’œuvre, et l’auteur se refuse à voir en la folie de Lucia la clé de son existence, non sans rendre à la fille de l’écrivain un peu de la consistance, de l’étrange pouvoir d’éclairement qu’on lui avait jusqu’alors dénié. Sans prétendre psychanalyser Lucia, Carol Loeb Shloss retrace son parcours artistique et se charge de mettre en lumière la place qu’elle occupa au sein de sa famille.
Ce livre, par sa richesse et son exigence, s’inscrit dans la tradition inaugurée dans le champ joycien par Ellmann avec sa monumentale biographie et poursuivie par le Nora de Brenda Maddox (1988). Cette dernière tentait de montrer le « vrai visage » de Molly Bloom ; Carol Loeb Shloss nous révèle quant à elle celui de Milly, la fille-photo dans Ulysse,et dévoile furtivement ceux d’Issy et d’Anna Livia Plurabelle, héroïnes de Finnegans Wake. Par ailleurs, l’auteur brosse les paysages que traverse Lucia : le monde de la danse (Raymond et Isadora Duncan, Mary Wigman, etc.), mais aussi celui de la psychanalyse naissante et des hôpitaux psychiatriques.
L’ouvrage nous présente l’existence de Lucia dans le détail : l’enfance à Trieste, à Zurich, la vie de jeune femme aventureuse à Paris qui débouchera sur les années noires, l’errance à Dublin, l’enfermement. S’appuyant sur l’abondante correspondance de Joyce ainsi que sur de nombreux témoignages inédits, Carol Loeb Shloss parvient à décrypter certains aspects du roman familial de Lucia. Nombreuses sont les anecdotes qui donnent corps au récit. Ainsi, l’enfance misérable, ses peines et ses joies que l’on dirait inspirées de The Kid. Carol Loeb Shloss raconte aussi comment père et fille, après l’avoir longtemps cherché à travers Paris, rencontrèrent Chaplin en 1921 devant un spectacle de Guignol sur les Champs-Elysées.
Une folie éclairante trace le chemin, et peut-être est-ce le père qui est à la traîne de sa fille, laquelle danse comme il écrit. Cela donne lieu à une rêverie de la part de Carol Loeb Shloss, une des pages les plus poignantes de son livre : « Il y a deux artistes dans la pièce. Tous deux sont au travail. Joyce observe et apprend. Ils communiquent d’une voix secrète et silencieuse. Le tracé de la plume, les mouvements du corps entrent dans un dialogue artistique. … Le père consigne par écrit l’éloquence de la danse qui se suffit à elle-même. Il voit dans le corps de sa fille le hiéroglyphe d’une écriture mystérieuse : les mouvements de la danseuse sont pour lui l’alphabet de l’inexprimable. » Et si, de tous les monstres d’écriture que porta le vingtième siècle, deux des plus forts en gueule, Joyce, Céline, se retrouvaient là, pareillement béats au spectacle de la danse ?
Meudon, un pavillon gris. L’ermite Céline gribouille au rez-de-chaussée, peine à mater le cauchemar de l’Histoire en couchant ses borborygmes sur le papier, tandis qu’à l’étage, Lucette donne des cours de danse. Voyage au bout de la nuit fut dédié à une danseuse, et, de Voyage à Rigodon, la danse, toujours la danse, traverse l’univers célinien. Ah! c’est beau une danseuse. Lucia, Lucette, petites lumières pour le bout de la nuit, féeries.
Joyce broie le langage, consume les dictionnaires, les grammaires de toutes les langues qu’il rencontre, et elles sont nombreuses. Finnegans Wake, creuset nocturne. L’écriture de Joyce comme une singulière alchimie dont jaillit un langage d’avant Babel, d’avant la différence. Parole d’avant la schize, d’avant la Genèse, contemporaine précisément de la « schizophrénie » de Lucia. Parole de nuit qui ne connaît de lumière que celle, vacillante, proposée par la danseuse Lucia. Parole d’« avant les mots », peut-être, comme le suggéra Antonin Artaud, en 1931, lorsqu’il évoquait le rythme et les syncopes du théâtre balinais. Parole scénique, épiphanique par excellence. Samuel Beckett, déchiffrant l’œuvre en cours à mesure qu’elle s’écrivait, constatait que lorsque le sens est « danse », les mots de Joyce précisément « dansent ». De fait, les vocables joyciens rendent leur sens de manière plus proprement chorégraphique que sémantique. Ils sont gestes avant d’être signifiants. Avant les mots, la danse.
Finnegans Wake est, pour une très large part, illisible. Il s’y déploie une langue tissée d’absolu, régie par cette nuit fameuse où toutes les vaches sont noires. Le livre paraît au seuil de la seconde guerre mondiale. Joyce, au chapitre 13, y recycle de façon tragi-drolatique la fable de la cigale et de la fourmi. La nuit recouvre l’Europe ? Eh bien, dansons. Une danse de nuit sous les étoiles, en réponse à l’infâme. Féerie, maintenant. Une ronde à la Giambattista Vico. Et aussi, on l’aura compris, le cauchemar sans cesse rejoué de l’Histoire.
Sous la nuit et ses voiles/ que nous illuminons/comme un cercle d’étoiles,/tournons en choeur, tournons, tournons
(Marceline Desbordes-Valmore, « La Danse de nuit »)
Le destin de Lucia : un kaléidoscope brisé
Dans la section Biographies, ce Lucia Joyce trouve éminemment sa place sur le rayonnage joycien de nos bibliothèques, tout à côté du James Joyce (1959) de Richard Ellmann, du Nora (1988) de Brenda Maddox, du John Stanislaus Joyce (1998) de John Wyse Jackson et Peter Costello, mais aussi du Sylvia Beach and the Lost Generation (1985) de Noel Riley Fitch (paru en France en 2011 sous le titre Sylvia Beach, une Américaine à Paris, ce livre a obtenu le Prix Tour-Montparnasse).
Publié à New York en 2003 chez Farrar, Strauss & Giroux, le livre de Carol Loeb Shloss s’ouvre sur une longue introduction qui fait état de la quasi-impossibilité dans laquelle se trouvait alors tout biographe de Lucia. En effet, l’entreprise de Carol Loeb Shloss s’est heurtée à nombre de résistances. Beaucoup de documents disparurent du vivant de Lucia, mais aussi à mesure que l’universitaire américaine progressait dans la rédaction de cette biographie. Joyce lui-même aurait détruit de nombreuses lettres, marquant ainsi le début d’une longue période de censure : l’histoire de Lucia est aussi celle de documents égarés ou tout bonnement subtilisés à la vue du monde.
Stephen Joyce, petit-fils et ayant-droit de l’écrivain, avait obtenu de Brenda Maddox qu’elle retire de son Nora un chapitre consacré à Lucia. A sa parution, le livre de Carol Loeb Shloss souffrit à son tour de la censure orchestrée par Stephen Joyce. A l’issue d’un procès qui opposa l’universitaire au James Joyce Estate, le matériel retiré de Lucia Joyce put être diffusé sur internet selon les conditions du fairuse (http://www.lucia-the-authors-cut.info), bien que le site ne soit accessible que depuis le territoire américain. Maintenant que l’œuvre de Joyce appartient en Europe au domaine public, les passages inédits de la biographie de Lucia pourraient réintégrer le livre à l’occasion de sa traduction en français.
Loin cependant d’être lacunaire, le portrait de Lucia ici proposé se veut une « biographie expérimentale » dirigée contre les images canoniques de Lucia (la fille dans l’ombre du père). L’intérêt de ce Lucia Joyce réside davantage dans la perspective adoptée que dans les faits exposés. Carol Loeb Shloss offre un éclairage inédit sur Joyce et son œuvre à travers le prisme de sa fille, tirant néanmoins parti de matériel encore inexploité, tel que les archives Richard Ellmann conservées à l’Université de Tulsa, ou celles de Lucia déposées au University College de Londres (précieux « Real Life of James Joyce » de la main de la fille), mais aussi de carnets tenus par Joyce pendant la rédaction de Finnegans Wake, lesquels permettent d’exposer de façon plus nuancée et complexe la personnalité de Lucia ainsi que le caractère composite des personnages féminins de Finnegans Wake (celui d’Issy en particulier). Le travail génétique opéré par l’universitaire américaine à partir des carnets de Joyce ainsi que de ses brouillons ne figure pas dans la version imprimée de son texte, mais il pourrait aisément trouver sa place dans cette traduction française, et sans doute serait-ce souhaitable : Lucia nous apparaîtrait ainsi telle que Carol Loeb Shloss l’avait initialement souhaité.
Le portrait de Lucia en créature dansant dans l’ombre de son père, établi notamment par Ellmann, méritait quelques nuances. Carol Loeb Shloss a à cœur de multiplier les sources, et de les examiner scrupuleusement. Mais Lucia ne nous est visible qu’à travers un kaléidoscope à jamais brisé par la censure, sous des jours multiples : tantôt comme cette fille un peu « dérangée » que l’on pouvait rencontrer, pendant les années 30, sur les Champs-Elysées ; ou bien comme le membre le plus « raisonnable » de sa famille ; ou alors comme cette enfant gaie et enjouée virevoltant par les rues de Trieste ; ou encore comme une danseuse remarquable. L’image d’une jeune schizophrène errante et suicidaire, aux yeux noyés de Véronal, est par ailleurs tenace et, si elle infléchit durablement notre compréhension de Lucia, elle n’est pas seule à déterminer son destin. Les photographies qui nous sont parvenues reflètent des réalités parcellaires et contradictoires : une tendre enfant vêtue de blanc, une adolescente absorbée dans un livre, une jeune femme élégante au regard troublant, en passant par la sauvage merveille qui danse sur Schubert, sans oublier, bien entendu, telle photographie datée de 1935, où, égarée plus que jamais, Lucia semble nous adresser un signe de la main.
Accablé par les troubles de sa fille, Joyce aimait à penser qu’elle était seule en mesure de comprendre son dernier livre. Finnegans Wake, le livre d’un fou pour les seuls fous ? Ce serait par trop simple, et Carol Loeb Shloss prend garde à ne pas faire de sa biographie un traité d’antipsychiatrie. On aurait pu s’attendre à une méditation dans le prolongement du Foucault d’Histoire de la folie. Mais, habilement, inspirée en cela du Madness and Modernism de Louis A. Sass, convoquant une fois encore l’ombre, la lumière et la vue, c’est bien plutôt dans Surveiller et punir que Carol Loeb Shloss trouve une clé. Lucia, la fille-lumière, est sans cesse traversée par le regard scrutateur — un regard de myope, cependant — de son père. Celui-ci se tient autant au sommet d’une croulante tour de Babel qu’au cœur d’un panoptique affectif d’où il lui est loisible de percer sa fille du regard, de l’enfermer dans la rêverie obscure et clairvoyante de Finnegans Wake. « Que fait-il sous terre, cet idiot ? » aurait demandé Lucia à la mort de Joyce, « il n’arrête pas de nous surveiller ».
Joyce estimait qu’une « feuille transparente » séparait Ulysse, le livre du jour, de la folie. Qu’en est-il de Finnegans Wake, le livre de la nuit ? Gageons avec Carol Loeb Shloss qu’au contact de Lucia, la feuille translucide s’est couverte de mots, signes chantants et dansants. Folle opacité que celle de Finnegans Wake. En d’autres termes, « in the buginning is the woid, in the muddle is the sounddance and thereinofter you’re in the unbewised again, vund vulsyvolsy ». Passage combien dansant du Wake, qui se glose approximativement par : « Au commencement est le vide du verbe, puis vient la gadoue du son et de la danse et nous retournerons encore à l’ignorance, tournoyant valsant sans fin. »