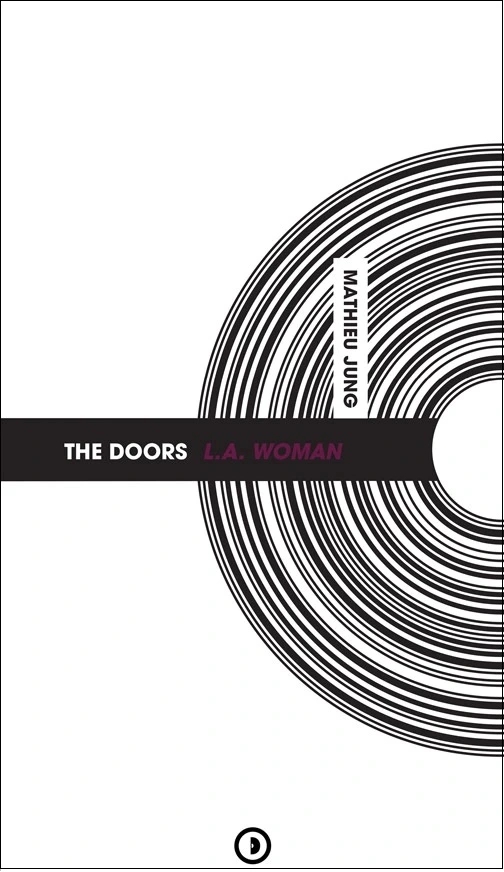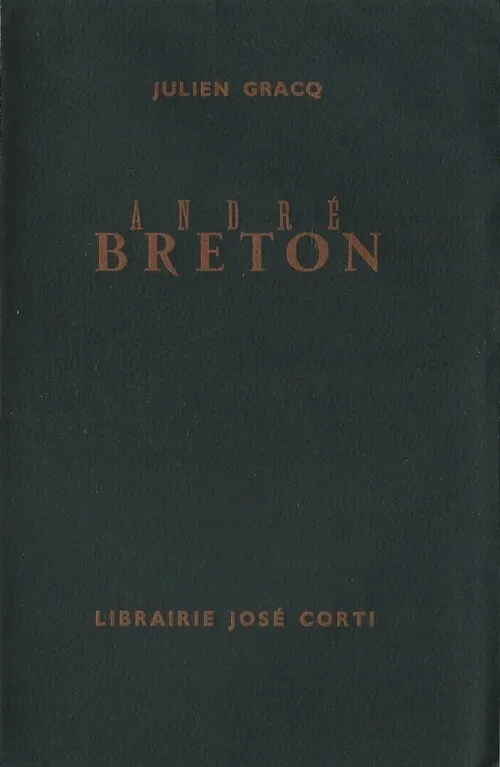Je songe souvent à ces curieux traducteurs que furent Hölderlin transposant Sophocle dans un allemand gréco-antique, Joyce bricolant des passages de Finnegans Wake en italien, Pound s’occupant du Shijing. Chacun, à sa manière paroxystique, parvient à déloger l’œuvre — la langue de l’œuvre — pour la faire signifier non pas seulement ailleurs, mais tout bonnement autrement. Le critère de justesse étant, par définition, aboli par le nom même de l’auteur (et c’est a priori une raison irrecevable), ou alors s’agit-il d’une justesse d’une autre nature, qui se révèle selon un autre plan qu’il faudrait alors définir (ce n’est pas l’objet ici). Hölderlin, Joyce, Pound n’étant, à l’évidence, pas Tartempion. La traduction devient alors réécriture du poème.
Réécriture ? Plutôt : la traduction est un autre état du poème.
Dans l’absolu, je peux imaginer une tartempionisation générale du poème. Face à la surenchère puérile autour du nom de l’auteur, pareille proposition peut même être salutaire. Démocratisation du poème, de sa traduction, par le biais même du geste de traduire. Mais oui. Variation sur le mot fameux de Ducasse : « La poésie doit être faite par tous. Non par un. » Mais c’est aller un peu vite en besogne, accorder trop de crédit à l’absolu.
Parce que traduire, c’est précisément une besogne, un besoin, un travail du et dans le poème, relatif au poème, en relation étroite avec lui. C’est une tâche ou un devoir (Aufgabe) à laquelle s’astreignent d’horribles travailleurs. Je songe à Ivar Ch’Vavar traduisant Lewis Carroll en picard, élaborant, aussi bien, un dictionnaire de son parler natal, dont il est peut-être le dernier locuteur [voir ici].
Traduire est un geste qui, s’il procède de la communication, reste profondément vernaculaire. Je le dis et le répète (l’idée n’est pas tout à fait de moi) le poème appartient à un grand dialecte. À la lettre, traduire vous donne des nouvelles du pays. Tout à l’inverse d’une globalisation triviale et unifiante, mondialisante, laquelle ne nous dit rien, ne nous donne des nouvelles de rien, traduire revient à œuvrer dans l’ambigu spécifique du poème, c’est œuvrer dans un monde particulier, forcément restreint dans sa nature et dans ses effets, qui résulte de ce que la poésie est profondément endémique, au sens où l’on parle d’espèces endémiques menacées.
*
Lorsque je traduis, cela ne regarde que moi. C’est ce que semblent dire Pound, Joyce ou Hölderlin. Je ne m’autorise que de moi-même, ou à mieux dire, de mon rapport particulier à la langue. Il convient donc de lire les traductions comme autant d’avatars, y compris monstrueux, du poème.
*
Lorsqu’Ivar revient sur sa traduction initialement parue dans le Jardin ouvrier du long poème The Wreck of the Deutschland de Gerard Manley Hopkins, vingt-cinq ans plus tard, voici ce qu’il m’écrit, relativement à sa manière de traduire « flesh », qui se traduirait d’ordinaire par « chair » :
J’emploie « viande » dans son sens vulgaire de « chair de l’homme » et de la femme, c’est un mot provocateur, mais en même temps je remonte à sa signification première : vivanda, ce qui sert à la vie, ce qui fait vivre, du latin vivere, « vivre », en donnant ici au mot vie un sens mystique : la vie qui vient par la veine du Christ, la vie éternelle. Je tiens ensemble le mot très vulgaire, intolérable (comme dans « exhiber sa viande ») et une idée christique (plutôt que chrétienne), cette chair même, du Christ et des martyrs (« chair » un mot que je n’emploie pas, qui ne passe pas dans ma poésie) qui est là à panteler sur la croix, ou le gril, et si on nous la donne à manger, même symboliquement, c’est parce qu’elle apporte la vie éternelle. — Eh ! bien, c’est une traduction forcée, mais ça n’est pas un contresens.
Mais je ne suis pas étonné d’apprendre que j’ai fait de vrais contresens : le contraire m’eût étonné. Il y a des endroits où je ne pouvais pas ne pas glisser, sans doute. Mais pour moi, ce n’est pas si important. Ce que j’ai voulu, c’est rendre quelque chose de la folie du poème original, et en particulier sa musicalité démente, ce qui tient de la gageure en français, et tenir la distance sans perdre le fil du chant, ce chant halluciné.
Voilà ce que je pense. Je t’ai d’abord dit non, que ça ne me paraissait pas possible de republier cette traduction. Je m’en souvenais comme de quelque chose de monstrueux et d’impossible. Mais en retapant le texte pour toi, je l’entendais, et en l’entendant je voyais. Je voyais les images. Je l’ai relu plusieurs fois avec la voix et je me suis persuadé qu’il pouvait reparaître [cf. Europe n° 1129, dossier consacré à Gerard Manley Hopkins, avec d’autres traductions, parfois aussi hardies, des poèmes de Hopkins].
Viander le poème, donc. Immense leçon. Et il ne s’agit pas de l’esthétique du ratage ou du cafouillage, dont tout le monde se réclame, sous l’égide de Beckett. Plutôt, le travail du poème, dont Ivar parle si bien. Et j’ajouterais, ou paraphraserais, la besogne de traduire.
*
A-t-on jamais pensé à traduire le titre du célèbre essai de Walter Benjamin sur la traduction (Die Aufgabe des Übersetzers) par La Besogne du traducteur ? Il se pourrait que oui. Je ne suis pas allé vérifier. Bien entendu, cela heurte nos habitudes, coutumiers que nous sommes de La Tâche du traducteur (Maurice de Gandillac trad.).
Besogne consone avec besoin. Même étymologie. La traduction, qui est, nous rappelle Benjamin, un art sans muse, est affaire de besoin, essentiellement dans le besoin. Celui du poème, de sa viande même.
Le geste de traduire relève de la pauvreté. Il est pauvre : il ne bénéficie pas de théorie véritable, bien que le discours sur la traduction occupe un rayonnage important de nos bibliothèques, comme en témoignent le Poétique du traduire d’Henri Meschonnic, les 650 pages de The Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Mona Baker éd.), ou bien cette énorme Histoire des traductions en langue française chez Verdier. Dernièrement, Josée Kamoun a fait paraître un Dictionnaire amoureux de la traduction… Mais tous ces discours, aussi savants ou énamourés soient-ils, ne me semblent s’arc-bouter sur aucune théorie véritable. On a beau tâcher d’en établir la poétique, ou alors d’en proposer un discours amoureux, d’en risquer une histoire (et encore, seulement dans une langue donnée) ou une encyclopédie qu’on n’a de cesse de mettre à jour — la traduction répugne à se présenter comme un objet stable dans le champ théorique.